Calmer la poussière
+2
Sahkti
obi
6 participants
Page 1 sur 1
 Calmer la poussière
Calmer la poussière
Je poste un début de nouvelle pour essayer de me motiver soit à continuer soit à laisser tomber. D'habitude ça vient tout de suite ou ça ne vient pas. Là, ça piétine. Bref, je patauge . Merci de vos avis.
Un froissement dans le drapé lourd de l'air à l'extérieur ; des pas précipités sur la terre durcie. « Papa ! » Face à moi l'homme assis sur le lit en a brusquement saisi le bord et sa jambe droite, nerveuse, va chercher sous le sommier grossier je ne sais quelle force qu'il y aurait cachée. A la base du gros orteil qui s'est relevé, je suis, dans la pénombre, le lent mouvement de rotation du pied. Bientôt régulier, il reconnaît les bords d'un léger trou que l'habitude a creusé puis, rassuré, s'apaise. « C'est ma fille » précise l'homme et je vois naître par-dessus le masque des douleurs la bienveillance d'un amour indescriptible.
L'entrée de la case s'est obscurcie. « Il m'aime. Vraiment. Regarde Papa ! » Le moment est solennel. Imprévu. Nous devions terminer cet après-midi l'entretien, seuls. Mavunyi avait préféré la tenir éloignée de tout cela. « Désirée, nous avons un hôte ! » Devant le doux, le tendre profil sémitique de la jeune fille, semblable à ceux que j'ai admirés en Ethiopie il y a quelques années, je commence à admettre ce que je refusais jusque-là de comprendre. On peut sacrifier beaucoup pour l'amour.
****
Sans doute est-ce le prénom de Désirée qui, en un instant, m'a replongé dans ma propre existence. J'étais, de l'avis de tous, un fils à papa, à maman aussi d'ailleurs et même si mon éducation avait été bien dirigée, je l'avais toujours envisagée comme un dû. Les privations de mes parents, leur abnégation me paraissaient aller de soi : je ne me suis découvert égoïste que très tard. Jaloux de ma sœur , rien n'a pu me calmer, pas même le récit quasi épique des efforts de mes géniteurs pour m'obtenir, moi, l'aîné. Combien j'avais été espéré, attendu, désiré ! Trois si longues années ! Comment osais-je des reproches absurdes ? Quel sentiment maladif et laid ! Mais trente-cinq ans de litanies admiratives devant mes capacités, mes efforts et mes triomphes : « Ta naissance nous a vraiment comblés !...Tu es un si bon fils ! » n'avaient réussi qu'à me planter au cœur la seule question qui m'importât , celle qui avait gâché ma vie : « Dans ce cas, pourquoi m'avoir donné une sœur ? »
Cette irritation était si forte et me donnait une telle mauvaise conscience que j'avais fini, dans un sursaut de logique suicidaire, par l'étendre : d'ailleurs, pourquoi me créer moi ? Et à quoi bon enfanter des milliers de gosses qui mourraient silencieux, le ventre gonflé, les yeux agrandis d'hébétude et de faim, qui éclateraient sous les bombes, glisseraient dans la boue ou sous la poussière ensoleillée, cramponnés à un fusil ? Pourquoi élever des photographes de guerre dont les témoignages, pour esthétiques et véridiques qu'ils fussent, ne feraient pas bouger d'un iota une quelconque nation ? Bref, à quoi bon l'homme sur terre ? Mes années à l'agence me l'avaient appris : ce type de formulation n'était pas le bon. « Trop sérieux ! Mon gars, il faut accrocher ! Pense au jeu de mots pour capter l'attention ! Sois inventif ! » Mais tout cela m'importait trop pour que je reste léger.
Après un week-end à tapisser, peindre et aménager notre nid d'amoureux, j'ai ramassé mon dos en miettes, je l'ai rangé sous ma tendinite et ma contracture à l'épaule et j'ai bafouillé avec ce qui me restait de sens du devoir et le soupçon d'ironie voulue : « Dis, tu ne crois pas qu'il y a autre chose à faire dans la vie que s'embêter à pondre des gosses en plus ?» Non, Dorothée ne croyait pas. Dorothée était têtue. Ses hanches larges, paisibles, souriaient. Elle attendait. Son heure viendrait. Silencieuse et douce, elle souriait à mon angoisse. Et je l'aimais.
****
Je sais qu'il n'y aura jamais rien de commun entre Mavunyi et moi. Rien et j'en remercie un dieu auquel je ne crois pas. Je répète dans ma tête : « Rien, merci mon dieu ! » mais pour continuer à l'interroger, pour ne pas m'enfuir en hurlant dans les collines, j'ai besoin de penser que cette douleur a quelque chose que je connais. Oui, je sens , je veux sentir que c'est avec elle que j'ai composé ou avec sa sœur jumelle. Voilà de cela trois semaines, j'étais un homme libre. J'exerçais le métier que j 'avais choisi. « Trop dangereux, disait Dorothée» mais c'était une tendre inquiétude, pas un reproche. Elle avait accepté, en fier petit soldat.. Plusieurs fois j'étais parti au danger : Liban, Iraq, Bosnie,Egypte, Zimbabwe. Elle gérait. Nous étions un couple moderne. Après quelques années, nous nous étions décidés, puisque Dorothée souhaitait des enfants. Sa première grossesse n'avait duré que quatre mois. Hélas, la deuxième débutait difficilement. Il y avait eu une alerte inquiétante. Avec ma mauvaise conscience, j'avais glissé stylos, carnets et quelques objectifs sigma dans ma besace. Destination : la Syrie. Lorsque je suis rentré elle était à l'hôpital. Je suis retourné voir l'infirmière en chef parce que c'est ce que l'on fait quand sa femme est à l'hôpital. Bouchra était rassurante. La fois précédente, elle m'avait montré une photographie de son mari et d'elle vingt ans plus tôt, devant la mosquée des Omeyyades à Alep, appuyés au minaret. Elle l'évoquait avec dans la voix une contraction de nostalgie que démentait son indifférence affichée: « Je vous dis ça au cas où vous y passeriez mais ça n'a pas grande importance ... ». J'avais cru comprendre qu'elle n'avait pas eu d'enfant.
Son minaret, classé au patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O n'était plus qu'un amas blanchâtre effondré au pied de colonnes tremblantes. J'avais menti : « Je n'ai pas pu accéder à ce quartier, désolé ! » Je prêtai une attention distraite au discours de circonstance que je connaissais par cœur . Certes, reporter photographe était un beau métier mais dangereux, qui avait des répercussions sur mes proches autant sinon plus que sur moi-même. Je hochais la tête avec application. Le stress permanent n'était pas bon pour une grossesse déjà à risques. Je récitai tous les confiteor que l'on m'imposait.
J'avais déjà renoncé à repartir sur un front avant une petite année. « Correspondant de guerre , ça concerne les aspects diplomatiques, économiques ou humanitaires ; tu n'es pas obligé de zigzaguer entre les tirs de mortier pour faire du bon boulot, serinait Robert, mon rédacteur en chef qui voulait donner sa chance à son neveu photographe. Les articles de fond, c'est bien aussi Pat ! J'en ai besoin : tu as l'expérience , le recul nécessaire pour les écrire, toi ! ». Mais, privé de ma dose d'adrénaline coutumière, je dépérissais. « Diplomatiques » se traduisait pour moi par hypocrites, « économiques » préfigurait un endormissement rapide, quant à « humanitaires », le French Doctor et son sac de riz sur l'épaule me secouaient, plus de vingt ans après, d'un franc mépris. J'avais peu lu avant de prendre l'avion. Les commémorations en tout genre - cette année c'était 1914, dans quatre ans on remettrait ça - sans parler de tous les films et livres sur la shoah avaient fini par m'horripiler. Se souvenir, soit, mais de là à s'empêcher de vivre pour macérer dans le jus du passé...Je voulais ne rien savoir par avance ou le moins possible. Découvrir. Après tout, c'était mon métier... Stromae explosait sur les ondes et son « Papaoutai » lancinant laissait résonner en moi les longs regards de silence de Dorothée. Une mode, un album. Tout cela finirait bien par passer.
Le ciel de Kigali était bleu, très haut comme souvent sur la terre d'Afrique. Quelque chose d'impalpable pèse sur votre tête, sans lourdeur, vous obligeant à regarder, isolant un objet, un paysage, un homme, pour distinguer ce qui d'ordinaire reste invisible. Et ce que je voyais me ravissait. Les quelques images ramassées sur internet étaient bien en dessous de la splendeur simple des lieux. Par pur esprit de contradiction, sitôt descendu de l'avion, j'étais parti en jeep à Akagera pour narguer Robert - bien inutilement car il n'en saurait rien - . Je m'étais accordé , à moi seul, mon escapade. A deux heures et demie de route vers l'Est et pour moins d'une centaine de dollars j'ai retrouvé l'admiration et la stupeur de mon premier voyage au Kenya, le plaisir d'une trop brève incursion au Sérengeti tanzanien, derrière le fleuve. Bien sûr, la guerre avait abîmé le parc ; après quoi, il avait fallu le rétrécir pour installer et nourrir survivants et rapatriés. Mais le naturel paisible des bufles, l'élégance des girafes fragiles et les hippopotames broutant, placides, au petit matin frais m'emplissaient à nouveau d'une incroyable paix. J'ai pourtant mitraillé, par habitude sans doute, par avidité, des centaines de photos un peu fébriles parfois, où pourtant rien d'autre ne transparaissait que cet accord magique des arbres verts s'élançant avec hardiesse de la terre si rouge vers la beauté du ciel. Placides, les babouins me regardaient. La magie n'existe qu'à l'aune du réel. J'avais un reportage à réaliser. Mais je prenais mon temps. « Imprègne-toi bien de l'ambiance !»m'avait dit Robert. Je m'imprégnais si bien que je décidai de rédiger rien que pour moi quelques pages de l'enchantement qui me tenait. Après toutes les horreurs qui avaient défilé devant mon objectif, je m'étonnais de l'émotion profonde, naïve , chaque jour renouvelée, que me causait encore la vision des animaux. Digne, leur seule violence restait celle de la faim à rassasier.
La jeep avait du kilomètre au compteur, trafiqué bien sûr et la croûte de boue et de poussière qui la recouvrait me rassurait plutôt.De toute façon, mieux valait ne pas trop s'interroger sur son état. Léonard, qui la conduisait, la connaissait bien. Entre eux c'était une histoire d'amour. Il la bichonnait. Y dormait, souvent y mangeait, ne la quittait guère des yeux. Sa débrouillardise, son T-shirt troué : Chicago en lettres rouges et blanches sur fond bleu, son sourire perpétuel et son abord facile m'ouvraient la confiance des villageois partout où nous passions. Il connaissait tout le monde. Le coffre où il engouffrait ou au contraire dont il sortait des paquets bâchés en échange de quelques billets fiévreux me restait inaccessible. J'emportais toujours avec moi mes appareils. Après quelques jours je ne m'inquiétai plus pour ma valise à l'arrière de la voiture : personne n'y toucherait. Je ne me rappelle plus les noms des villages, des victimes, l'exacte description de toutes les horreurs confessées ou racontées à mi-voix. Très vite, j'ai su que je ne pourrais pas retracer sur quelques colonnes, confiner à deux ou trois photos toute la détresse et le sang dont on m'abreuvait. Très vite j'ai compris que ce n'était pas au journaliste que s'adressait l'expérience que je vivais. D'autres étaient venus là avant moi, en même temps que moi, viendraient encore après moi. Ils avaient écrit. Longuement. Ils écriraient encore. Avec éloquence. Alors, qu'est-ce que je faisais ici ? Je pensais à Dorothée. Ma place n'était-elle pas auprès d'elle ? Pris entre lassitude et dégoût, j'attendais je ne sais quoi.
C'est alors que quelqu'un a évoqué brièvement, avec tristesse et un peu d'envie malgré tout, l'histoire de Mavunyi et j'ai su que je devais le chercher. Je suis allé le dire à la Kagera, le soir . Les roseaux indifférents ne m'ont pas répondu. J'ai attendu, accroupi, le cœur battant de mon étrange résolution. Soudain, un bec en sabot sortant des papyrus a émis quelques claquements. Avec sa petite houppe derrière le crâne et son lourd appendice nasal, il avait l'air aussi gauche que moi.Mais je savais combien son outil est efficace pour trouver, dans une becquée de terre arrachée au marais, la proie qu'il convoite. Gris et sans peur dans le soir rosé, il me regardait droit dans les yeux. Je lui ai souri : moi aussi, je réussirais !
Il m'arrive aujourd'hui encore, de moins en moins souvent parce que je me fais vieux, que le marbre les protège , d'arroser la poussière au -dessus d'elles et ce n'est jamais leur prénom qui, d'abord, revient vers moi comme une conjuration du mal et de la souffrance. Quarante ans après les événements c'est toujours à une autre que je m'adresse, une qui ne m'a pas connu, que je n'ai jamais vue : Emelence . Mais d'abord, c'est lui qu'il nous a fallu trouver. Je ne me rappelle plus son nom ; son prénom seul m'emplit toujours le cœur d'un long serrement. Sans la détermination de Léonard, j'aurais sans doute renoncé tellement cette recherche aveugle, incertaine, pouvait paraître vaine. Dans ces temps troublés, les histoires, horribles ou merveilleuses, se répandent vite, leurs héros se modifient : les conteurs ne sont redevables d'aucune exactitude, seulement de la vérité de la substance. Et la substance, à cette heure, sous ce ciel, était terrifiante et poisseuse, vraie à n'en pas douter hélas ! J'avais accroché cette histoire Dieu sait par quel hasard, presque par mégarde ; et résolu de la démêler.Nous avons visité plusieurs villages, frappé à des portes, interrogé, recoupé des informations et, au bout de tout cela, j'ai fini par me laisser tomber en sueur, éreinté, sur l'unique chaise de la pièce, en face de Mavunyi. Il ne comprenait pas. D'autres étaient passés depuis vingt ans, il avait raconté, répondu aux mêmes questions. Ils étaient repartis.
« C'est toujours la même histoire tu sais. Rien n'a changé. Tu la connais puisque tu es ici. » Son sourire infiniment las mais bienveillant me jaugeait. « Pourquoi es-tu venu ? »
Un froissement dans le drapé lourd de l'air à l'extérieur ; des pas précipités sur la terre durcie. « Papa ! » Face à moi l'homme assis sur le lit en a brusquement saisi le bord et sa jambe droite, nerveuse, va chercher sous le sommier grossier je ne sais quelle force qu'il y aurait cachée. A la base du gros orteil qui s'est relevé, je suis, dans la pénombre, le lent mouvement de rotation du pied. Bientôt régulier, il reconnaît les bords d'un léger trou que l'habitude a creusé puis, rassuré, s'apaise. « C'est ma fille » précise l'homme et je vois naître par-dessus le masque des douleurs la bienveillance d'un amour indescriptible.
L'entrée de la case s'est obscurcie. « Il m'aime. Vraiment. Regarde Papa ! » Le moment est solennel. Imprévu. Nous devions terminer cet après-midi l'entretien, seuls. Mavunyi avait préféré la tenir éloignée de tout cela. « Désirée, nous avons un hôte ! » Devant le doux, le tendre profil sémitique de la jeune fille, semblable à ceux que j'ai admirés en Ethiopie il y a quelques années, je commence à admettre ce que je refusais jusque-là de comprendre. On peut sacrifier beaucoup pour l'amour.
****
Sans doute est-ce le prénom de Désirée qui, en un instant, m'a replongé dans ma propre existence. J'étais, de l'avis de tous, un fils à papa, à maman aussi d'ailleurs et même si mon éducation avait été bien dirigée, je l'avais toujours envisagée comme un dû. Les privations de mes parents, leur abnégation me paraissaient aller de soi : je ne me suis découvert égoïste que très tard. Jaloux de ma sœur , rien n'a pu me calmer, pas même le récit quasi épique des efforts de mes géniteurs pour m'obtenir, moi, l'aîné. Combien j'avais été espéré, attendu, désiré ! Trois si longues années ! Comment osais-je des reproches absurdes ? Quel sentiment maladif et laid ! Mais trente-cinq ans de litanies admiratives devant mes capacités, mes efforts et mes triomphes : « Ta naissance nous a vraiment comblés !...Tu es un si bon fils ! » n'avaient réussi qu'à me planter au cœur la seule question qui m'importât , celle qui avait gâché ma vie : « Dans ce cas, pourquoi m'avoir donné une sœur ? »
Cette irritation était si forte et me donnait une telle mauvaise conscience que j'avais fini, dans un sursaut de logique suicidaire, par l'étendre : d'ailleurs, pourquoi me créer moi ? Et à quoi bon enfanter des milliers de gosses qui mourraient silencieux, le ventre gonflé, les yeux agrandis d'hébétude et de faim, qui éclateraient sous les bombes, glisseraient dans la boue ou sous la poussière ensoleillée, cramponnés à un fusil ? Pourquoi élever des photographes de guerre dont les témoignages, pour esthétiques et véridiques qu'ils fussent, ne feraient pas bouger d'un iota une quelconque nation ? Bref, à quoi bon l'homme sur terre ? Mes années à l'agence me l'avaient appris : ce type de formulation n'était pas le bon. « Trop sérieux ! Mon gars, il faut accrocher ! Pense au jeu de mots pour capter l'attention ! Sois inventif ! » Mais tout cela m'importait trop pour que je reste léger.
Après un week-end à tapisser, peindre et aménager notre nid d'amoureux, j'ai ramassé mon dos en miettes, je l'ai rangé sous ma tendinite et ma contracture à l'épaule et j'ai bafouillé avec ce qui me restait de sens du devoir et le soupçon d'ironie voulue : « Dis, tu ne crois pas qu'il y a autre chose à faire dans la vie que s'embêter à pondre des gosses en plus ?» Non, Dorothée ne croyait pas. Dorothée était têtue. Ses hanches larges, paisibles, souriaient. Elle attendait. Son heure viendrait. Silencieuse et douce, elle souriait à mon angoisse. Et je l'aimais.
****
Je sais qu'il n'y aura jamais rien de commun entre Mavunyi et moi. Rien et j'en remercie un dieu auquel je ne crois pas. Je répète dans ma tête : « Rien, merci mon dieu ! » mais pour continuer à l'interroger, pour ne pas m'enfuir en hurlant dans les collines, j'ai besoin de penser que cette douleur a quelque chose que je connais. Oui, je sens , je veux sentir que c'est avec elle que j'ai composé ou avec sa sœur jumelle. Voilà de cela trois semaines, j'étais un homme libre. J'exerçais le métier que j 'avais choisi. « Trop dangereux, disait Dorothée» mais c'était une tendre inquiétude, pas un reproche. Elle avait accepté, en fier petit soldat.. Plusieurs fois j'étais parti au danger : Liban, Iraq, Bosnie,Egypte, Zimbabwe. Elle gérait. Nous étions un couple moderne. Après quelques années, nous nous étions décidés, puisque Dorothée souhaitait des enfants. Sa première grossesse n'avait duré que quatre mois. Hélas, la deuxième débutait difficilement. Il y avait eu une alerte inquiétante. Avec ma mauvaise conscience, j'avais glissé stylos, carnets et quelques objectifs sigma dans ma besace. Destination : la Syrie. Lorsque je suis rentré elle était à l'hôpital. Je suis retourné voir l'infirmière en chef parce que c'est ce que l'on fait quand sa femme est à l'hôpital. Bouchra était rassurante. La fois précédente, elle m'avait montré une photographie de son mari et d'elle vingt ans plus tôt, devant la mosquée des Omeyyades à Alep, appuyés au minaret. Elle l'évoquait avec dans la voix une contraction de nostalgie que démentait son indifférence affichée: « Je vous dis ça au cas où vous y passeriez mais ça n'a pas grande importance ... ». J'avais cru comprendre qu'elle n'avait pas eu d'enfant.
Son minaret, classé au patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O n'était plus qu'un amas blanchâtre effondré au pied de colonnes tremblantes. J'avais menti : « Je n'ai pas pu accéder à ce quartier, désolé ! » Je prêtai une attention distraite au discours de circonstance que je connaissais par cœur . Certes, reporter photographe était un beau métier mais dangereux, qui avait des répercussions sur mes proches autant sinon plus que sur moi-même. Je hochais la tête avec application. Le stress permanent n'était pas bon pour une grossesse déjà à risques. Je récitai tous les confiteor que l'on m'imposait.
J'avais déjà renoncé à repartir sur un front avant une petite année. « Correspondant de guerre , ça concerne les aspects diplomatiques, économiques ou humanitaires ; tu n'es pas obligé de zigzaguer entre les tirs de mortier pour faire du bon boulot, serinait Robert, mon rédacteur en chef qui voulait donner sa chance à son neveu photographe. Les articles de fond, c'est bien aussi Pat ! J'en ai besoin : tu as l'expérience , le recul nécessaire pour les écrire, toi ! ». Mais, privé de ma dose d'adrénaline coutumière, je dépérissais. « Diplomatiques » se traduisait pour moi par hypocrites, « économiques » préfigurait un endormissement rapide, quant à « humanitaires », le French Doctor et son sac de riz sur l'épaule me secouaient, plus de vingt ans après, d'un franc mépris. J'avais peu lu avant de prendre l'avion. Les commémorations en tout genre - cette année c'était 1914, dans quatre ans on remettrait ça - sans parler de tous les films et livres sur la shoah avaient fini par m'horripiler. Se souvenir, soit, mais de là à s'empêcher de vivre pour macérer dans le jus du passé...Je voulais ne rien savoir par avance ou le moins possible. Découvrir. Après tout, c'était mon métier... Stromae explosait sur les ondes et son « Papaoutai » lancinant laissait résonner en moi les longs regards de silence de Dorothée. Une mode, un album. Tout cela finirait bien par passer.
Le ciel de Kigali était bleu, très haut comme souvent sur la terre d'Afrique. Quelque chose d'impalpable pèse sur votre tête, sans lourdeur, vous obligeant à regarder, isolant un objet, un paysage, un homme, pour distinguer ce qui d'ordinaire reste invisible. Et ce que je voyais me ravissait. Les quelques images ramassées sur internet étaient bien en dessous de la splendeur simple des lieux. Par pur esprit de contradiction, sitôt descendu de l'avion, j'étais parti en jeep à Akagera pour narguer Robert - bien inutilement car il n'en saurait rien - . Je m'étais accordé , à moi seul, mon escapade. A deux heures et demie de route vers l'Est et pour moins d'une centaine de dollars j'ai retrouvé l'admiration et la stupeur de mon premier voyage au Kenya, le plaisir d'une trop brève incursion au Sérengeti tanzanien, derrière le fleuve. Bien sûr, la guerre avait abîmé le parc ; après quoi, il avait fallu le rétrécir pour installer et nourrir survivants et rapatriés. Mais le naturel paisible des bufles, l'élégance des girafes fragiles et les hippopotames broutant, placides, au petit matin frais m'emplissaient à nouveau d'une incroyable paix. J'ai pourtant mitraillé, par habitude sans doute, par avidité, des centaines de photos un peu fébriles parfois, où pourtant rien d'autre ne transparaissait que cet accord magique des arbres verts s'élançant avec hardiesse de la terre si rouge vers la beauté du ciel. Placides, les babouins me regardaient. La magie n'existe qu'à l'aune du réel. J'avais un reportage à réaliser. Mais je prenais mon temps. « Imprègne-toi bien de l'ambiance !»m'avait dit Robert. Je m'imprégnais si bien que je décidai de rédiger rien que pour moi quelques pages de l'enchantement qui me tenait. Après toutes les horreurs qui avaient défilé devant mon objectif, je m'étonnais de l'émotion profonde, naïve , chaque jour renouvelée, que me causait encore la vision des animaux. Digne, leur seule violence restait celle de la faim à rassasier.
La jeep avait du kilomètre au compteur, trafiqué bien sûr et la croûte de boue et de poussière qui la recouvrait me rassurait plutôt.De toute façon, mieux valait ne pas trop s'interroger sur son état. Léonard, qui la conduisait, la connaissait bien. Entre eux c'était une histoire d'amour. Il la bichonnait. Y dormait, souvent y mangeait, ne la quittait guère des yeux. Sa débrouillardise, son T-shirt troué : Chicago en lettres rouges et blanches sur fond bleu, son sourire perpétuel et son abord facile m'ouvraient la confiance des villageois partout où nous passions. Il connaissait tout le monde. Le coffre où il engouffrait ou au contraire dont il sortait des paquets bâchés en échange de quelques billets fiévreux me restait inaccessible. J'emportais toujours avec moi mes appareils. Après quelques jours je ne m'inquiétai plus pour ma valise à l'arrière de la voiture : personne n'y toucherait. Je ne me rappelle plus les noms des villages, des victimes, l'exacte description de toutes les horreurs confessées ou racontées à mi-voix. Très vite, j'ai su que je ne pourrais pas retracer sur quelques colonnes, confiner à deux ou trois photos toute la détresse et le sang dont on m'abreuvait. Très vite j'ai compris que ce n'était pas au journaliste que s'adressait l'expérience que je vivais. D'autres étaient venus là avant moi, en même temps que moi, viendraient encore après moi. Ils avaient écrit. Longuement. Ils écriraient encore. Avec éloquence. Alors, qu'est-ce que je faisais ici ? Je pensais à Dorothée. Ma place n'était-elle pas auprès d'elle ? Pris entre lassitude et dégoût, j'attendais je ne sais quoi.
C'est alors que quelqu'un a évoqué brièvement, avec tristesse et un peu d'envie malgré tout, l'histoire de Mavunyi et j'ai su que je devais le chercher. Je suis allé le dire à la Kagera, le soir . Les roseaux indifférents ne m'ont pas répondu. J'ai attendu, accroupi, le cœur battant de mon étrange résolution. Soudain, un bec en sabot sortant des papyrus a émis quelques claquements. Avec sa petite houppe derrière le crâne et son lourd appendice nasal, il avait l'air aussi gauche que moi.Mais je savais combien son outil est efficace pour trouver, dans une becquée de terre arrachée au marais, la proie qu'il convoite. Gris et sans peur dans le soir rosé, il me regardait droit dans les yeux. Je lui ai souri : moi aussi, je réussirais !
Il m'arrive aujourd'hui encore, de moins en moins souvent parce que je me fais vieux, que le marbre les protège , d'arroser la poussière au -dessus d'elles et ce n'est jamais leur prénom qui, d'abord, revient vers moi comme une conjuration du mal et de la souffrance. Quarante ans après les événements c'est toujours à une autre que je m'adresse, une qui ne m'a pas connu, que je n'ai jamais vue : Emelence . Mais d'abord, c'est lui qu'il nous a fallu trouver. Je ne me rappelle plus son nom ; son prénom seul m'emplit toujours le cœur d'un long serrement. Sans la détermination de Léonard, j'aurais sans doute renoncé tellement cette recherche aveugle, incertaine, pouvait paraître vaine. Dans ces temps troublés, les histoires, horribles ou merveilleuses, se répandent vite, leurs héros se modifient : les conteurs ne sont redevables d'aucune exactitude, seulement de la vérité de la substance. Et la substance, à cette heure, sous ce ciel, était terrifiante et poisseuse, vraie à n'en pas douter hélas ! J'avais accroché cette histoire Dieu sait par quel hasard, presque par mégarde ; et résolu de la démêler.Nous avons visité plusieurs villages, frappé à des portes, interrogé, recoupé des informations et, au bout de tout cela, j'ai fini par me laisser tomber en sueur, éreinté, sur l'unique chaise de la pièce, en face de Mavunyi. Il ne comprenait pas. D'autres étaient passés depuis vingt ans, il avait raconté, répondu aux mêmes questions. Ils étaient repartis.
« C'est toujours la même histoire tu sais. Rien n'a changé. Tu la connais puisque tu es ici. » Son sourire infiniment las mais bienveillant me jaugeait. « Pourquoi es-tu venu ? »
obi- Nombre de messages : 553
Date d'inscription : 24/02/2013
 Re: Calmer la poussière
Re: Calmer la poussière
Bonjour obi. Il conviendrait de donner un titre, même à l'essai. Merci.

Sahkti- Nombre de messages : 31659
Age : 50
Localisation : Suisse et Belgique
Date d'inscription : 12/12/2005
 Re: Calmer la poussière
Re: Calmer la poussière
J'aime bien le regard désabusé de ce photographe qui arpente la planète, la touche d'exotisme qui ressort de ses pérégrinations. Son regard sur son existence et ses amours passés sonnent assez justes, il y transparait une forme de mélancolie je trouve. Quelques réflexions pertinentes aussi sur les tares de la race humaine.
Une bonne écriture, vous devriez continuer cette nouvelle.
Une bonne écriture, vous devriez continuer cette nouvelle.

Jano- Nombre de messages : 1000
Age : 54
Date d'inscription : 06/01/2009
 Calmer la poussière
Calmer la poussière
Sahkti, le titre sera Calmer la poussière.
Merci à Jano qui a pris la peine de répondre à mon appel et m'a donné du courage pour terminer tant bien que mal un texte pénible à écrire.
Calmer la poussière
Un froissement dans le drapé lourd de l'air à l'extérieur ; des pas précipités sur la terre durcie. « Papa ! » Face à moi l'homme assis sur le lit en a brusquement saisi le bord et sa jambe droite, nerveuse, va chercher sous le sommier grossier je ne sais quelle force qu'il y aurait cachée. A la base du gros orteil qui s'est relevé, je suis, dans la pénombre, le lent mouvement de rotation du pied. Bientôt régulier, il reconnaît les bords d'un léger trou que l'habitude a creusé puis, rassuré, s'apaise. « C'est ma fille, Mukanoheli... » précise l'homme et je vois naître par-dessus le masque des douleurs la bienveillance d'un amour indescriptible.
L'entrée de la case s'est obscurcie. « Il m'aime. Vraiment. Regarde Papa ! » Le moment est solennel. Imprévu. Nous devions terminer cet après-midi l'entretien, seuls. Mavunyi avait préféré la tenir éloignée de tout cela. « Désirée, nous avons un hôte ! » Devant le doux, le tendre profil sémitique de la jeune fille, semblable à ceux que j'ai admirés en Ethiopie il y a quelques années, je commence à admettre ce que je refusais jusque-là de comprendre. On peut sacrifier beaucoup pour l'amour.
****
Sans doute est-ce le prénom de Désirée qui, en un instant, m'a replongé dans ma propre existence. J'étais, de l'avis de tous, un fils à papa, à maman aussi d'ailleurs et même si mon éducation avait été bien dirigée, je l'avais toujours envisagée comme un dû. Les privations de mes parents, leur abnégation me paraissaient aller de soi : je ne me suis découvert égoïste que très tard. Jaloux de ma sœur , rien n'a pu me calmer, pas même le récit quasi épique des efforts de mes géniteurs pour m'obtenir, moi, l'aîné. Combien j'avais été espéré, attendu, désiré ! Trois si longues années ! Comment osais-je des reproches absurdes ? Quel sentiment maladif et laid ! : « Ta naissance nous a vraiment comblés !...Tu es un si bon fils ! » Trente-cinq ans de litanies admiratives devant mes capacités, mes efforts et mes triomphes n'avaient pourtant réussi qu'à me planter au cœur la question qui avait gâché ma vie : « Dans ce cas, pourquoi m'avoir donné une sœur ? »
Cette irritation était si forte et me donnait une telle mauvaise conscience que j'avais fini, dans un sursaut de logique suicidaire, par l'étendre : pourquoi d'ailleurs me créer moi ? Et à quoi bon enfanter sur ce globe des milliers de gosses qui mourraient silencieux, le ventre gonflé, les yeux agrandis d'hébétude et de faim, qui éclateraient sous les bombes, glisseraient dans la boue ou sous la poussière ensoleillée, cramponnés à un fusil ? Pourquoi élever des photographes de guerre dont les témoignages, pourtant esthétiques, véridiques aussi, ne feraient pas bouger d'un iota une quelconque nation ? Bref, à quoi bon l'homme sur terre ? Mes années à l'agence me l'avaient appris : ce type de formulation était mauvais. « Trop sérieux ! Mon gars, faut accrocher ! Pense à la formule qui claque, même au jeu de mots pour capter l'attention ! Sois inventif ! » Mais tout cela m'importait trop pour que je reste léger.
Après un week-end à tapisser, peindre et aménager notre nid d'amoureux, j'avais ramassé mon dos en miettes, l'avais rangé sous ma tendinite et ma contracture à l'épaule et j'ai bafouillé avec ce qui me restait de sens du devoir et le soupçon d'ironie voulue : « Dis, tu ne crois pas qu'il y a autre chose à faire dans la vie que s'embêter à pondre des gosses en plus ?» Non, Dorothée ne croyait pas. Dorothée était têtue. Ses hanches larges, paisibles, souriaient. Son bras doré, taché de peinture, où scintillaient des poils blonds, s'est reposé sur son ventre. Elle attendait. Son heure viendrait. Silencieuse et douce, elle souriait à mon angoisse. Et moi, je l'aimais.
****
Je sais à présent qu'il n'y aura jamais rien de commun entre Mavunyi- Pierre Claver et moi. Rien et j'en remercie un dieu auquel je ne crois pas. Je répète sottement dans ma tête : « Rien, merci mon dieu ! » mais pour continuer à l'interroger, pour ne pas m'enfuir en hurlant dans les collines, j'ai besoin de penser que cette douleur a quelque chose que je connais. Oui, je sens , je veux sentir que c'est avec elle que j'ai composé ou avec sa sœur jumelle. Voilà de cela trois semaines, j'étais un homme libre. J'exerçais le métier que j 'avais choisi. « Trop dangereux, disait Dorothée» mais c'était une tendre inquiétude, pas un reproche. Elle avait accepté, en fier petit soldat.. Plusieurs fois j'étais parti au danger : Liban, Iraq, Bosnie, Egypte, Zimbabwe. Elle gérait. Nous étions un couple moderne. Après quelques années, j'avais fini par me décider, puisque Dorothée souhaitait des enfants. Sa première grossesse n'avait duré que quatre mois. Hélas, la deuxième débutait difficilement. Il y avait eu une alerte inquiétante. Avec ma mauvaise conscience, j'avais glissé stylos, carnets et quelques objectifs Sigma dans ma besace. Destination : la Syrie. Lorsque je suis rentré elle était à l'hôpital. Je suis retourné voir l'infirmière en chef parce que c'est ce que l'on fait quand sa femme est à l'hôpital. Bouchra était rassurante. La fois précédente, elle m'avait montré une photographie de son mari et d'elle vingt ans plus tôt, devant la mosquée des Omeyyades à Alep, appuyés au minaret. Elle l'évoquait avec dans la voix une contraction de nostalgie que démentait son indifférence affichée: « Je vous dis ça au cas où vous y passeriez mais ça n'a pas grande importance ... ». J'avais cru comprendre qu'elle n'avait pas eu d'enfant.
Son minaret, classé au patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O n'était plus qu'un amas blanchâtre effondré au pied de colonnes tremblantes. J'avais menti : « Je n'ai pas pu accéder à ce quartier, désolé ! » J'avais prêté une attention distraite au discours de circonstance que je connaissais par cœur . Certes, reporter photographe était un beau métier mais dangereux, qui avait des répercussions sur mes proches autant sinon plus que sur moi-même. Je hochais la tête avec application. Le stress permanent n'était pas bon pour une grossesse déjà à risques. Je récitai tous les confiteor que l'on m'imposait.
J'avais déjà renoncé à repartir sur un front avant une petite année. « Correspondant de guerre , ça concerne les aspects diplomatiques, économiques ou humanitaires ; tu n'es pas obligé de zigzaguer entre les tirs de mortier pour faire du bon boulot, serinait Robert, mon rédacteur en chef qui voulait donner sa chance à son neveu photographe. Les articles de fond, c'est bien aussi Pat ! J'en ai besoin : tu as l'expérience , le recul nécessaire pour les écrire, toi ! ». Mais, privé de ma dose d'adrénaline coutumière, je dépérissais. « Diplomatiques » se traduisait pour moi par hypocrites, « économiques » préfigurait un endormissement rapide, quant à « humanitaires », la comédie du French Doctor avec son sac de riz sur l'épaule me secouaient, plus de vingt ans après, d'un franc mépris. J'avais peu lu avant de prendre l'avion. Les commémorations en tout genre - cette année c'était 1914, dans quatre ans on remettrait ça - sans parler de tous les films et livres sur la shoah avaient fini par m'horripiler. Se souvenir, soit, mais de là à s'empêcher de vivre pour macérer dans le jus du passé...Je voulais ne rien savoir par avance ou le moins possible. Découvrir. Après tout, c'était mon métier... Stromae explosait sur les ondes et son « Papaoutai » lancinant laissait résonner en moi les longs regards de silence de Dorothée. Une mode, un album. Tout cela finirait bien par passer.
Le ciel de Kigali était bleu, très haut comme souvent sur la terre d'Afrique. Quelque chose d'impalpable pèse sur votre tête, sans lourdeur, vous obligeant à regarder, isolant un objet, un paysage, un homme, pour distinguer ce qui d'ordinaire reste invisible. Et ce que je voyais me ravissait. Les quelques images ramassées sur internet étaient bien en dessous de la splendeur simple des lieux. Par pur esprit de contradiction, sitôt descendu de l'avion, j'étais parti en jeep à Akagera pour narguer Robert - bien inutilement car il n'en saurait rien - . Je m'étais accordé , à moi seul, mon escapade. A deux heures et demie de route vers l'Est et pour moins d'une centaine de dollars j'ai retrouvé l'admiration et la stupeur de mon premier voyage au Kenya, le plaisir d'une trop brève incursion au Sérengeti tanzanien, derrière le fleuve. Bien sûr, la guerre avait abîmé le parc ; après quoi, il avait fallu le rétrécir pour installer et nourrir survivants et rapatriés. Mais le naturel paisible des bufles, l'élégance des girafes fragiles et les hippopotames broutant, avides, au petit matin frais m'emplissaient à nouveau d'une incroyable paix. J'ai mitraillé, par habitude sans doute, par avidité, des centaines de photos un peu fébriles parfois, où pourtant rien d'autre ne transparaissait que cet accord magique des arbres verts s'élançant avec hardiesse de la terre si rouge vers la beauté du ciel. Placides, les babouins me regardaient. La magie n'existe qu'à l'aune du réel. J'avais un reportage à réaliser. Mais je prenais mon temps. « Imprègne-toi bien de l'ambiance !»m'avait dit Robert. Je m'imprégnais si bien que je décidai de rédiger rien que pour moi quelques pages de l'enchantement qui me tenait. Après toutes les horreurs qui avaient défilé devant mon objectif, je m'étonnais de l'émotion profonde, naïve , chaque jour renouvelée, que me causait encore la vision des animaux. Digne, leur seule violence restait celle de la faim à rassasier.
La jeep avait du kilomètre au compteur, trafiqué bien sûr et la croûte de boue et de poussière qui la recouvrait me rassurait plutôt.De toute façon, mieux valait ne pas trop s'interroger sur son état. Pour Léonard, qui la conduisait, elle n'avait aucun secret. Entre eux c'était une histoire d'amour. Il la bichonnait. Y dormait, souvent y mangeait, ne la quittait guère des yeux. Sa débrouillardise, son T-shirt troué : Chicago en lettres rouges et blanches sur fond bleu, son sourire perpétuel et son abord facile m'ouvraient la confiance des villageois partout où nous passions. Il connaissait tout le monde. Le coffre où il engouffrait parfois, d'où au contraire il sortait souvent des paquets bâchés en échange de quelques billets fiévreux me restait inaccessible. J'emportais toujours avec moi mes appareils. Après quelques jours j'ai fini de m'inquiéter pour ma valise à l'arrière de la voiture : personne n'y toucherait. Je ne me rappelle plus les noms des villages, des victimes, l'exacte description de toutes les horreurs confessées ou racontées à mi-voix. Très vite, j'ai su que je ne pourrais pas retracer sur quelques colonnes, confiner à deux ou trois photos toute la détresse et le sang dont on m'abreuvait. Très vite j'ai compris que ce n'était pas au journaliste que s'adressait l'expérience que je vivais. D'autres étaient venus là avant moi, en même temps que moi, viendraient encore après moi. Ils avaient écrit. Longuement. Ils écriraient encore. Avec éloquence. Alors, qu'est-ce que je faisais ici ? Je pensais à Dorothée. Ma place n'était-elle pas auprès d'elle ? Pris entre lassitude et dégoût, j'attendais je ne sais quoi.
C'est alors que quelqu'un a évoqué brièvement, avec tristesse et un peu d'envie malgré tout, l'histoire de Mavunyi et j'ai su que je devais le chercher. Je suis allé le dire à la Kagera, le soir. Indolente et lisse, elle reflétait le glissement infini des nuages. Les roseaux indifférents ne m'ont pas répondu. J'ai attendu, accroupi, le cœur battant de mon étrange résolution. Soudain, un bec en sabot sortant des papyrus a émis quelques claquements. Avec sa petite houppe derrière le crâne et son lourd appendice nasal, il était aussi gauche que moi.Mais je savais combien son outil est efficace pour trouver, dans une becquée de terre arrachée au marais, la proie qu'il convoite. Gris et sans peur dans le soir rosé, il me regardait droit dans les yeux. Je lui ai souri : moi aussi, je réussirais !
Il m'arrive aujourd'hui encore, de moins en moins souvent parce que je me fais vieux, que le marbre les protège , d'arroser la poussière au -dessus d'elles et ce n'est jamais leur prénom qui, d'abord, revient vers moi comme une conjuration du mal et de la souffrance. Quarante ans après les événements c'est toujours à une autre que je m'adresse, une qui ne m'a pas connu, que je n'ai jamais vue : Emelence . Mais d'abord, c'est lui qu'il nous a fallu trouver. Je ne me rappelle plus son nom ; son prénom seul m'emplit toujours le cœur d'un long serrement. Sans la détermination de Léonard, j'aurais sans doute renoncé tellement cette recherche tâtonnante pouvait paraître vaine. Dans ces temps troublés, les histoires, horribles ou merveilleuses, se répandent vite, leurs héros se modifient : les conteurs ne sont redevables d'aucune exactitude, seulement de la vérité de la substance. Et la substance, à cette heure, sous ce ciel, était terrifiante et poisseuse, vraie à n'en pas douter hélas ! Au hasard de mes déambulations, j'avais accroché cette histoire presque par mégarde et résolu de la démêler. Au Sud-Est, dans la région des chutes, nous avons parcouru plusieurs villages, frappé à des portes, interrogé, recoupé des informations et, au bout de tout cela, j'ai fini par me laisser tomber en sueur, éreinté, sur l'unique chaise de la pièce, en face de Mavunyi. Il ne comprenait pas. D'autres reporters étaient passés depuis vingt ans. Parfois on l'avait nommé Pierre, de son deuxième prénom, mais lui n'aimait pas. «Appelle-moi Mavunyi, ça fera plus « exotique » ajoute-t-il avec un demi-sourire désabusé. » Comme tous ses voisins Mavunyi avait raconté, comme eux, il avait répondu aux questions. Et les journalistes étaient repartis. Sa réserve, son phrasé lent, volontairement détaché me semblait-il, démangeaient ma curiosité.
« C'est toujours la même histoire tu sais.Pour nous tous. Rien n'a changé. Tu la connais puisque tu es ici. » Un sourire infiniment las mais bienveillant me jaugeait. Ironique peut-être ? « Pourquoi es-tu venu, toi ? »
J'ai décollé mes lèvres sèches. J'avais dans la gorge mon discours bien rodé, les accents de sincérité, les formules qui font mouche et toute mon expérience de l'interview. « Je voulais vérifier les choses par moi-même, être sûr du choix de l'angle adopté, affiner un point, éclairer d'autres pans de l'histoire... Je voudrais des photos avec un cadrage particulier, des filtres spéciaux, un objectif différent...Il me semble que... ». Mais rien. J'étais bouche bée. Soudain il ne me restait plus que la vérité. Stupéfait, j'ai fermé la bouche, baissé les yeux ; j'avais dans le cœur, résonnant à l'infinisur les carreaux du corridor, un sanglot de Dorothée. Alors j'ai reniflé, un peu bêtement ; je regardais sans les voir mes deux mains ouvertes sur mes genoux : « Je ne sais pas pourquoi je suis venu...Cette histoire, ton histoire n'est pas pour mon journal... » C'avait été presque imperceptible : Mavunyi s'était redressé, soudain attentif. « ...Je crois...elle est pour moi... » Gêné, j'ai étouffé un mauvais rire et puis soudain j'ai tout lâché : la fatigue, le dégoût, Dorothée à l'hôpital, les commémorations de 14-18, la shoah, le French doctor. Le sol flottait en vagues sous mes yeux au gré d'un refrain têtu. Je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que je pleurnichais un peu au fond de l'obscurité.
Ca n'a pas duré longtemps. Deux, trois minutes ? Soudain, le rythme a resurgi dans ma tête : « Alors on danse ?... » j'ai pensé sottement. Quoi faire d'autre ? J'ai failli rire. Un outil a craqué,ou le bord du lit peut-être et la honte m'a envahi jusqu'aux oreilles. J'ai brusquement refermé mes mains comme on claque une porte. La légèreté du silence m'a surpris. Mavunyi, immobile, attendait de croiser mon regard. Et ça a été comme une accolade, un salut grave. Juste à ce moment, j'ai perçu quelqu'un d'autre à l'intérieur. J'ai tourné la tête vers l'entrée. Un peu courbé, l'homme venait de poser contre le mur, à côté des autres, l'outil qu'il rapportait, une houe je crois. « J'ai terminé les rangées derrière les bananiers. » Me dévisageant à la dérobée, il attendait, indécis. Mavunyi s'est repris, très vite. « Voici Ntibagilirwa, qui m'aide à cultiver depuis... » Il a regardé son pied droit abîmé avec un petit pincement des lèvres. Encore toute une histoire à raconter, sûrement, que je ne saurai jamais.
« Ta fille est chez nous pour la journée, ne t'inquiète pas. » « Merci voisin... » Mavunyi marque un temps. « Je... ne m'inquiète pas. » Il y a dans sa voix une nuance étrange ; je l'ai notée mais suis incapable de l'interpréter. L'homme sort lentement, à reculons, attachant sur moi un long regard de méfiance. J'ai rêvé peut-être. Je n'ai pas aimé les yeux enfoncés, le bourrelet des sourcils sur le front bas. Curieusement, la mâchoire dure, la peau très noire me remuent encore. Et la défiance de l'homme. Je les écarte mais le moment est gâché : je propose à Mavunyi de me retirer. Mes impressions premières sont toujours très entières. C'est ce qui me rappelle qu'un jour, il y a très longtemps, j'ai été jeune.
Une voix étrange répond, à la fois détachée et pénétrée d'une souffrance qui fait mal à entendre. « Désirée aime son fils...Et son fils... aime Désirée je crois. Elle a la beauté de sa mère. »Mavunyi s'interrompt, se perd dans un souvenir, loin. J'ai honte, je suis un charognard ; je répugne soudain à la curée. Je n'ose finir de me relever et oscille, ridicule, les fesses en l'air, en équilibre instable. Sortir au plus vite, fuir la lourdeur de l'instant ! Il me semble que j'étouffe. . « Reste. Je vais te raconter. » Mavunyi s'est repris dans un ricanement amer. « Rien ne m'en empêchera.. » Il me tend un gobelet où je reconnais la traditionnelle et épaisse bière de banane. Cette boisson des campagnes torture depuis quelques jours déjà mes intestins d'Européen. Désolé ! Désignant mon ventre d'un air piteux, je pince les lèvres. Ma grimace est éloquente : Mavunyi a un petit pétillement dans l'oeil.Derrière le lit, il est aller puiser dans la jarre d'eau pour la préparation des repas. Au moment de verser, il se ravise et répand avec gravité quelques gouttes sur le sol. « Pour calmer la poussière ! Quand nous étions à l'école, Emelence s'en chargeait dans la classe, presque tous les matins. » Et dans ma gorge asséchée, c'est bien ce que fait l'eau, curieusement fraîche : calmer la poussière.
****
« Emelence était magnifique... Il n'y a pas de mots pour cela. Lorsque j'étais seul avec elle... au début, j'oubliais presque de respirer. » Une lumière monte de Mavunyi, s'élargit : « C'est comme quand tu descends au fleuve et que l'hippopotame joue avec son petit : jamais tu ne pourras dire combien c'est beau... ça fait peur aussi...» Un homme à peine plus âgé que moi mais dont les cheveux, blanchis par plaques, soulignent l'infortune, songe à sa jeunesse perdue et voici que j'entre de plain-pied dans ce qui, à une virgule du destin près , pourrait être ma propre vie.
Dans ce village comme aux alentours, beaucoup de jeunes hommes désiraient Emelence.Son corps mince aux os fins, légers était une caresse sur le flanc de la colline quand elle partait chercher l'eau. Elle avait la tête petite, des yeux aux cils immenses. Vive, elle détalait en bondissant comme les impalas quand les garçons cherchaient à l'arrêter. Il y avait chez elle la grâce d'une de ses ancêtres afars. Mavunyi était fou de fierté lorsqu'elle l'a choisi. Peut-être savait-il que le prix à payer serait lourd. Mais à quel point... ni l'un ni l'autre ne l'avait imaginé. Ils aimaient seulement l'heure du soir, la fraîcheur des roseaux après la poussière du jour. Comme on entend parler des fantômes, ils savaient les dangers de cette terre, vieille colonie déformée par les blancs mais surtout que leur vie pour toujours était là,entre le vert puissant des collines et le grand fleuve. Travaillant bien à l'école, ils rêvaient entre eux – sans trop y croire – d'aller un jour à la capitale pour étudier. Lui serait juriste, avocat peut-être, elle, infirmière parce que quand on a vingt ans, que l'on mange à sa faim et que les vaches prospèrent, on ne peut que vouloir du bien aux hommes. Amashyo, amashyo ngore !
Mavunyi a travaillé comme un fou dans les champs de ses cousins, chez son oncle ; il a enrichi toute la famille et son père n'a pas hésité à lui donner une vache à lui pour s'installer avec Emelence . En quelques années, le jeune couple a fait des merveilles. Emelence, en plus de son travail aux champs confectionne de la vannerie en papyrus, avec des feuilles de bananier. Elle tresse les roseaux et le bambou, réalise des couvercles de pots à lait. Igiseke, agaseke : son habileté et le soin apporté à la finition des paniers , la technique igihisi dans laquelle elle excellait ont établi sa réputation. Le cousin Rwandekwe vend ses vanneries presque jusqu' à Nairobi ! Il voyage beaucoup et Mavunyi lui a demandé une faveur : puisqu'il se rend de temps à autre au mercato d'Addis Abeba pour ses affaires, qu'il fasse un achat à sa place : une bague artistement travaillée. Les mines d'or de l'Ethiopie sont réputées et les artisans de sa capitale ont du génie dans la délicatesse avec laquelle ils manient le fil d'or, inventent et combinent des motifs, soignent le moindre détail d'une frise. Réclamer un bijou ? Jamais Emelence n'y a seulement songé. Mais avec une émotion contenue, presque honteuse, elle a maintes fois décrit à Mavunyi la splendeur de sa grand-mère drapée dans sa robe rouge, sa haute taille un peu dédaigneuse et la beauté de l'or éclatant sur sa peau noire au soleil du Danakil. Abey, que sa petite-fille n'a jamais connue mais que sa mère lui a racontée, est un modèle de liberté et d'indépendance pour Emelence. Peut-être Mavunyi saura-t-il un jour l'histoire de cette femme fière qui a fui le peuple afar afin de ne pas être mariée de force mais pour l'instant, tout ce qu'il désire c'est s'assurer qu'il mérite encore davantage l'amour d'Emelence. Malgré tous ses efforts, il n'a pas les moyens d'offrir à sa femme cette superbe parure où bracelet et bagues sont unis par une dentelle de chaînettes dessinant un enchevêtrement d'or envoûtant sur les longues mains d'ébène. Mais une bague, oui ! Et du mieux possible il a décrit à Rwandekwe le rêve d'Emelence, ce motif pour elle unique, celui d'Abey qui a su résister sans renier les siens.
Rwandekwe a accompli sa mission : il a négocié, et pour un prix avantageux, un anneau d'or aux reflets chauds. Le travail de l'orfèvre, qui a bien interprété les indications données, son amour de l'art s'y s'expriment avec éloquence. Le cœur du bijou rappelle la forme d'une demi- papaye, effilée à ses extrémités. Au centre, pas de graines noires mais un à-plat martelé. L'anneau s'élargit et s'évide pour rejoindre délicatement chaque pointe et dans l'espace ainsi dégagé s'enroule un fil d'or torsadé. Tout est d'une finesse exquise.
Mavunyi veut attendre la date anniversaire de leur union pour offrir son présent. Au début de juin cela fera deux ans qu'ils sont mariés et Désirée commencera peut-être à marcher. Deux mois de bonheur à imaginer la joie, la reconnaissance dans l'oeil de sa femme, ce sera son cadeau à lui ... Mais quelques jours plus tard, des rumeurs malsaines se propagent ; l'avion du président a été abattu et, comme toujours, les Interahamwe accusent « les cafards ». La radio des mille collines, qui distille son venin depuis presque deux ans, devient plus violente encore. L'opposition entre communautés, jalonnant l'histoire du pays depuis le départ des colonisateurs, est attisée une fois de plus. Emelence lui a maintes fois confié son malaise, sa peur, certains regards pleins de haine ou de sous-entendus qui l'enveloppaient, elle, l'étrangère, la tutsi. Jusqu'alors Mavunyi a dissipé ses peurs : contre les méchants et les imbéciles on ne peut rien que s'efforcer de vivre selon l'évangile, aimer et pardonner. Mais seul sous la nuit, lorsque Emelence et sa fille dorment, il lui arrive souvent de songer à ce destin contraire qui poursuit certains. La grand-mère a fui l'Ethiopie, s'est réfugiée ici et a épousé un tutsi - par quel terrible hasard?- quelques années à peine avant l'exil de 1959. Elle a pu rester au pays avec ses filles et son fils mais a dû courber le dos, vivre en tremblant . Emelence est née un an après le bannissement de son ethnie de l'administration et de l'enseignement du Rwanda. Elle sait qu'en 1990 plus d'un demi-millions de Tutsi, victimes de persécutions, se sont exilés. Elle sait que, depuis quelques années, la suspicion augmente envers les siens, depuis que le F.P.R. réfugié en Ouganda et qui milite pour le retour des réfugiés tutsi dans leur pays, a pénétré au Rwanda. Elle a dit son bonheur à Mavunyi l'année passée quand , à Arusha, on a fini par se mettre d'accord pour rapatrier les réfugiés. Bien sûr, tout toujours est difficile, fragile et menacé, mais leur enfant peut-être ne connaîtra pas la guerre, la défiance incessante. Et à regarder les pique-boeufs sur le dos des hippopotames, dans les marais , elle a voulu croire que les larves mauvaises peuvent être extirpées, que le bec éclatant , jaune ou rouge , d'un oiseau ami peut chasser les mouches et aussi la vermine et les verrues qui dénaturent un grand corps malhabile à se soigner lui-même ; pourvu qu'on ait foi et que l'on travaille dans la bonne direction, la vie vaut d'être vécue. « Aabana mwe !Il faut dormir maintenant...Abana mwe, buriabana mwe ! » Demain le soleil se lèvera une nouvelle fois et si tu es sage mon enfant, nous reviendrons saluer le fleuve. Il est notre vie et bien plus encore.Imana l'a voulu ainsi.
Mais bien vite en ce mois d'avril Mavunyi et Emelence doutent de ce qu'a vraiment voulu Imana. Partagés entre le dieu des chrétiens qu'on leur dit secourable et celui du prophète qui a protégé Emelence depuis l'Ethiopie jusqu'ici, ils sont perdus. De nouveau, les hommes sacrifient aux démons destructeurs ; la folie se relève dans tout le pays, déchirant les familles. Je n'ose plus interrompre Mavunyi pour lui demander des précisions. Sa respiration s'est apesantie. Il s'arrache des phrases par morceaux irréguliers et plus son récit avance, plus il se tasse sur le lit jusqu'à ne plus être qu'une voûte de regrets. « Emelence est partie très tôt un matin en direction de Kabarundo pour prendre des nouvelles d'une de ses sœurs et de ses neveux. Il y avait une demi-journée de marche... Lorsqu'elle est rentrée, ce n'était plus elle. » Mavunyi me regarde intensément ; des larmes lui gonflent les yeux. Tendus, presque exorbités. J'entends sa respiration, difficile. Il réfléchit, longuement, et puisque je suis venu jusqu'ici, si longtemps après, cherche une vérité à me dire. Une clé peut-être pour une des portes qui mènent à l'enfer. Oppressé, j'attends. Je voudrais que mon carnet et mon stylo disparaissent. Je ne peux plus rien noter.
« C'est ce jour-là que je l'ai perdue. Emelence n'a plus jamais souri. Ne regardait que l'intérieur, vide. Son âme a coulé quelque part dans les cailloux, caillé sur les herbes du chemin. Restait le souffle de la peur... » Il répète : « Le souffle de la peur...» et se tait longuement, hébété. « C'est pour ramener Désirée qu'elle est revenue. Sinon... » L'homme abattu mais stoïque revit sa déchirure. En marchant vers sa mort Emelence a rejoint les siens et l'Ethiopie, le pays lointain qui ne sera jamais la terre de Mavunyi. « Près des maisons elle a trouvé un gamin.Les Interahamwe avaient encerclé le village deux jours durant, trié les gens et attendu les ordres. Au matin du troisième, ils ont exécuté à la kalachnikov, frappé à coups de pierres, découpé à la machette. Pillé, violé, incendié tout ce qui n'était pas hutu. Elle a rampé dans les herbes ; elle entendait des gémissements. C'était sa sœur qui agonisait. Elle suppliait qu'on l'achève, dans la poussière rouge, couchée vers le ciel, presque nue à côté du cadavre de Sebishiha, l'un de ses fils. Quelques miliciens étaient encore là. Ca les mettait en joie. Elle a étouffé ses cris, est revenue abriter Désirée. Plus moyen de la raisonner : elle avait sa mort devant les yeux. Me suppliait. Dix fois, vingt fois elle m'a fait jurer de ne pas la laisser souffrir. Elle voulait passer vite, ne pas être violée, battue. ..Ne pouvait plus avaler quoi que ce soit mais donnait le sein à Désirée. Elle la regardait, me regardait. Ses yeux ne me voyaient pas, criaient : « Sauve-la ! » Pour elle-même, elle savait que ce ne serait pas possible. Elle chantait sans cesse à voix basse le chapitre 27 de l'évangile de Mathieu. Nous venions juste de célébrer les Pâques à l'église catholique de Kiabarondo. Une phrase revenait sans cesse dans sa transe : « C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour ». Moi je ne voulais plus le répéter mais elle insistait : « Tu me tueras dis ? promets-le moi ! »
Mavunyi pleurait à présent et tandis que son orteil fouissait avec rage, avec désespoir la poussière sous le sommier, il balançait son buste en me parlant, hypnotisé par les souvenirs. Muet, j'avais du mal à déglutir, presque honte de faire du bruit en respirant. Deux envies égales me tenaient : le faire taire ou bien apprendre tout, dans les moindres détails. Juste à ce moment je crois un souffle a fait tomber un pan de la moustiquaire sur lui. Dans la pénombre de la case un fantôme me découpait l'enfer avec soin, usant du vocabulaire parfois très précis que lui avait inculqué la bienfaisante école des colonisateurs, remâché durant vingt ans.
« Ils avaient déjà bu. Vociféraient dehors. Des insultes, des stupidités. Le groupe a dû les pousser dedans lui et les deux autres. Dieu sait ce qu'il avait pu leur raconter. Tous savaient qu'Emelence l'avait refusé lui, son argent et sa morgue pour me préférer moi et notre enfant. Grâce au ciel, après sa tétée Désirée avait glissé de la planche et dormait profondément par terre, sous le lit,dans un coin. Quand il a vu Emelence en face, il a reculé.Les autres ont parlé. Je ne les connaissais pas. « On ne te veut pas de mal. C'est pour elle qu'on est venus. Donne-la et on s'en va.» Emelence m'a agrippé. Ses doigts enfoncés dans mon bras me paralysaient presque. « On peut négocier ?... »j'ai dit mais je n'y croyais pas. Personne. Ils étaient trop nombreux dehors. On entendait les injures, les ricanements, les appels. Alors, dans la ceinture de celui qui se cachait derrière, je l'ai vue, la délivrance. Les autres avaient des machettes. » Mavunyi s'interrompt, me regarde droit, exigeant : « Lui, un pistolet... Celui de la gendarmerie française.» Je lui rend son regard. Je dis : « Je sais : un Glock 19 ou un Sig-Sauer peut-être ?... » Je me suis renseigné. J'ai fait, il y a quelque temps un reportage sur le G.I.G.N., les forces de police en général, tout ce qui vise, tire, tue et même les armes factices. Je parle , je dis n'importe quoi pour agiter le silence de plus en plus long. Moi qui ai toujours su ménager des respirations, des pauses dans mes entretiens, pour faire monter ou descendre la tension, j'ai perdu les rênes. Je ne supporte pas d'attendre ce qui vient. « ...Non, un Beretta...Je sais que son prénom c'est Pietro. C'était écrit en majuscules sur le canon...ça veut dire Pierre, me confie-t-il dans un souffle.» Il répète : « Pierre Claver...» Il ne me voit plus. Il a les yeux là-bas, dans la pluie des collines, qui roule, infinie, sur les feuilles glacées des bananiers. Je hoche la tête. Ca va s'arrêter....Ca doit s'arrêter sinon je vais...
« Alors j'ai marchandé avec Jean de Dieu. J'ai payé pour qu'il tue ma femme sans la violer, sans la livrer dehors, sans machette. Pour qu'il tire une seule balle, j'ai prié sa miséricorde. J'avais seulement la bague d'anniversaire de notre mariage. Emelence ne l'a jamais vue... C'était mon cadeau : j'ai acheté sa mort.Lui, peut-être qu'il a regretté de les avoir amenés. Il n'a pas osé tirer...Jean de Dieu aussi avait voulu l'épouser...» Du pied, Mavunyi caresse le sol de la case devant lui, égalise la poussière qui ondoie doucement en rides presque imperceptibles. Je romps le silence , avec hargne: « Tu l'as vengée ? » Silence. Un sourire étrange,surhumain, monte sur Mavunyi : « Le cœur déchire... On croit qu'on veut se venger, qu'on ne pardonnera jamais... Mais la vie pleut toujours, la poussière retombe. Et chaque jour passe... un seul à la fois... ne pas regarder trop loin... » J'ai la tête qui tourne un peu. La chaleur. Je pose une autre question ; je ne veux plus écouter le silence :
« Mais alors, qui a tiré ? »
« C'est moi, dit Mavunyi très calme. J'ai tiré dans son cœur. J'avais repéré l'endroit...toutes ces nuits d'insomnie, d'horreur où elle sanglotait ...je la tenais dans mes bras. Je savais...je pensais à ça . Elle avait ses yeux dans mes yeux. Elle a dit merci. Je crois qu'elle m'a souri mais je ne suis pas sûr. J'ai tiré encore une fois. Elle est morte tout de suite, les yeux ouverts. Désirée a ce sourire-là... »
J'ai fondu en larmes. « C'est la fatigue, j'ai dit. » Mavunyi s'est levé, est venu me consoler. « C'est fini.Ca fait si longtemps... Tu ne raconteras pas tout dans les journaux ; c'est pour toi. » Sa main est sur mon épaule. « Aimer c'est difficile...Que tu aies le courage ! » Quelque chose en moi se révolte. Et ce Jean de Dieu qui mérite si mal son nom, il est vivant encore ? Il a payé ? « Tu l'as accusé devant les gacacas au moins ? »
« J' ai pensé le faire mais il a tout de suite regretté. Il m'a demandé pardon. Je crois qu'il n'a tué personne. Dès qu'il est entré ce soir-là et qu'il l'a vue, il regrettait déjà... Il avait un fils, petit. »
« Il vit toujours dans le village ? C'est quoi son nom Rwandais ? »
« Bien sûr. Tu l'as vu. C'est Ntibagilirwa . » Et Mavunyi désigne la houe que le voisin a posée contre le mur tout à l'heure.
****
Un froissement dans le drapé lourd de l'air qui fraîchit à l'extérieur. Des pas précipités sur la terre durcie : « Papa ! Papa, il m'aime. Vraiment. Il veut m'épouser. »
« Désirée, voyons ! Nous avons un hôte ! »
« Regarde ce qu'il m'a offert !» Je vois la face de Mavunyi se décomposer devant une bague d'or très délicate. C'est un à-plat ovale effilé à ses extrémités. Avant de se rejoindre pour former l'anneau aux reflets chaleureux, deux fins rubans du même métal enserrent une torsade de fils d'or. Tout est d'une finesse exquise. Et dans les larges yeux noirs de Mukanoheli qui sourit à son père, l'amour est absolu. Face à moi Mavunyi vacille sur le lit . Il vient d'en saisir le bord ; sa jambe droite va chercher sous le sommier je ne sais quelle force pour le soutenir. Je n'ai pas posé tantôt la question de la tombe et une impression folle me saisit tout à coup. J'ai presque la certitude qu'Emelence est là, sous le lit, protégée, dans la calme pénombre où gît la poussière de la terre rwandaise. Mavunyi l'a gardée avec lui, avec Désirée et lorsqu'il sera mort, la sève de cette terre dont les racines puisent en Ethiopie nourrira jalousement Désirée, son mari s'il l'aime et les enfants de leurs enfants.
Après-demain soir, à Kanombé, je reprends l'avion pour Paris. Là-bas j'ai du travail : des photos d'animaux à trier, un article à rendre. Robert compte sur moi. Mais avant, je vais écrire quelques pages. Pas des pages à publier, juste pour ma fille quand elle sera grande - Dorothée m'a prévenu par S.M.S. : ce sera une fille- quelques pages qui lui expliqueront l'Afrique, les hippopotames le soir , la poussière partout sur la terre, près des fleuves et son deuxième prénom : Mukanoheli.
Amashyo, amashyo ngore!:salut adressé à quelqu'un : on lui souhaite d'avoir des troupeaux
Igiseke, agaseke, igihisi:types de paniers tressés et styles utilisés
Abana mwe!Buriabana mwe !: les enfants, il fait nuit !
Gacacas:tribunaux populaires établis pour juger les crimes de génocide au Rwanda, trop nombreux pour la justice ordinaire
Interahamwe : milices établies par le pouvoir hutu pour s'opposer aux tutsi de l'intérieur (« cafards ») ainsi qu'aux réfugiés qui auraient voulu rentrer au pays . Grâce à l'armement fourni par des puissances occidentales et à leur formation militaire elles ont planifié et exécuté le génocide. (Elles se sont appuyées sur la population locale hutu endoctrinée par la radio des mille collines.)
Merci à Jano qui a pris la peine de répondre à mon appel et m'a donné du courage pour terminer tant bien que mal un texte pénible à écrire.
Calmer la poussière
Un froissement dans le drapé lourd de l'air à l'extérieur ; des pas précipités sur la terre durcie. « Papa ! » Face à moi l'homme assis sur le lit en a brusquement saisi le bord et sa jambe droite, nerveuse, va chercher sous le sommier grossier je ne sais quelle force qu'il y aurait cachée. A la base du gros orteil qui s'est relevé, je suis, dans la pénombre, le lent mouvement de rotation du pied. Bientôt régulier, il reconnaît les bords d'un léger trou que l'habitude a creusé puis, rassuré, s'apaise. « C'est ma fille, Mukanoheli... » précise l'homme et je vois naître par-dessus le masque des douleurs la bienveillance d'un amour indescriptible.
L'entrée de la case s'est obscurcie. « Il m'aime. Vraiment. Regarde Papa ! » Le moment est solennel. Imprévu. Nous devions terminer cet après-midi l'entretien, seuls. Mavunyi avait préféré la tenir éloignée de tout cela. « Désirée, nous avons un hôte ! » Devant le doux, le tendre profil sémitique de la jeune fille, semblable à ceux que j'ai admirés en Ethiopie il y a quelques années, je commence à admettre ce que je refusais jusque-là de comprendre. On peut sacrifier beaucoup pour l'amour.
****
Sans doute est-ce le prénom de Désirée qui, en un instant, m'a replongé dans ma propre existence. J'étais, de l'avis de tous, un fils à papa, à maman aussi d'ailleurs et même si mon éducation avait été bien dirigée, je l'avais toujours envisagée comme un dû. Les privations de mes parents, leur abnégation me paraissaient aller de soi : je ne me suis découvert égoïste que très tard. Jaloux de ma sœur , rien n'a pu me calmer, pas même le récit quasi épique des efforts de mes géniteurs pour m'obtenir, moi, l'aîné. Combien j'avais été espéré, attendu, désiré ! Trois si longues années ! Comment osais-je des reproches absurdes ? Quel sentiment maladif et laid ! : « Ta naissance nous a vraiment comblés !...Tu es un si bon fils ! » Trente-cinq ans de litanies admiratives devant mes capacités, mes efforts et mes triomphes n'avaient pourtant réussi qu'à me planter au cœur la question qui avait gâché ma vie : « Dans ce cas, pourquoi m'avoir donné une sœur ? »
Cette irritation était si forte et me donnait une telle mauvaise conscience que j'avais fini, dans un sursaut de logique suicidaire, par l'étendre : pourquoi d'ailleurs me créer moi ? Et à quoi bon enfanter sur ce globe des milliers de gosses qui mourraient silencieux, le ventre gonflé, les yeux agrandis d'hébétude et de faim, qui éclateraient sous les bombes, glisseraient dans la boue ou sous la poussière ensoleillée, cramponnés à un fusil ? Pourquoi élever des photographes de guerre dont les témoignages, pourtant esthétiques, véridiques aussi, ne feraient pas bouger d'un iota une quelconque nation ? Bref, à quoi bon l'homme sur terre ? Mes années à l'agence me l'avaient appris : ce type de formulation était mauvais. « Trop sérieux ! Mon gars, faut accrocher ! Pense à la formule qui claque, même au jeu de mots pour capter l'attention ! Sois inventif ! » Mais tout cela m'importait trop pour que je reste léger.
Après un week-end à tapisser, peindre et aménager notre nid d'amoureux, j'avais ramassé mon dos en miettes, l'avais rangé sous ma tendinite et ma contracture à l'épaule et j'ai bafouillé avec ce qui me restait de sens du devoir et le soupçon d'ironie voulue : « Dis, tu ne crois pas qu'il y a autre chose à faire dans la vie que s'embêter à pondre des gosses en plus ?» Non, Dorothée ne croyait pas. Dorothée était têtue. Ses hanches larges, paisibles, souriaient. Son bras doré, taché de peinture, où scintillaient des poils blonds, s'est reposé sur son ventre. Elle attendait. Son heure viendrait. Silencieuse et douce, elle souriait à mon angoisse. Et moi, je l'aimais.
****
Je sais à présent qu'il n'y aura jamais rien de commun entre Mavunyi- Pierre Claver et moi. Rien et j'en remercie un dieu auquel je ne crois pas. Je répète sottement dans ma tête : « Rien, merci mon dieu ! » mais pour continuer à l'interroger, pour ne pas m'enfuir en hurlant dans les collines, j'ai besoin de penser que cette douleur a quelque chose que je connais. Oui, je sens , je veux sentir que c'est avec elle que j'ai composé ou avec sa sœur jumelle. Voilà de cela trois semaines, j'étais un homme libre. J'exerçais le métier que j 'avais choisi. « Trop dangereux, disait Dorothée» mais c'était une tendre inquiétude, pas un reproche. Elle avait accepté, en fier petit soldat.. Plusieurs fois j'étais parti au danger : Liban, Iraq, Bosnie, Egypte, Zimbabwe. Elle gérait. Nous étions un couple moderne. Après quelques années, j'avais fini par me décider, puisque Dorothée souhaitait des enfants. Sa première grossesse n'avait duré que quatre mois. Hélas, la deuxième débutait difficilement. Il y avait eu une alerte inquiétante. Avec ma mauvaise conscience, j'avais glissé stylos, carnets et quelques objectifs Sigma dans ma besace. Destination : la Syrie. Lorsque je suis rentré elle était à l'hôpital. Je suis retourné voir l'infirmière en chef parce que c'est ce que l'on fait quand sa femme est à l'hôpital. Bouchra était rassurante. La fois précédente, elle m'avait montré une photographie de son mari et d'elle vingt ans plus tôt, devant la mosquée des Omeyyades à Alep, appuyés au minaret. Elle l'évoquait avec dans la voix une contraction de nostalgie que démentait son indifférence affichée: « Je vous dis ça au cas où vous y passeriez mais ça n'a pas grande importance ... ». J'avais cru comprendre qu'elle n'avait pas eu d'enfant.
Son minaret, classé au patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O n'était plus qu'un amas blanchâtre effondré au pied de colonnes tremblantes. J'avais menti : « Je n'ai pas pu accéder à ce quartier, désolé ! » J'avais prêté une attention distraite au discours de circonstance que je connaissais par cœur . Certes, reporter photographe était un beau métier mais dangereux, qui avait des répercussions sur mes proches autant sinon plus que sur moi-même. Je hochais la tête avec application. Le stress permanent n'était pas bon pour une grossesse déjà à risques. Je récitai tous les confiteor que l'on m'imposait.
J'avais déjà renoncé à repartir sur un front avant une petite année. « Correspondant de guerre , ça concerne les aspects diplomatiques, économiques ou humanitaires ; tu n'es pas obligé de zigzaguer entre les tirs de mortier pour faire du bon boulot, serinait Robert, mon rédacteur en chef qui voulait donner sa chance à son neveu photographe. Les articles de fond, c'est bien aussi Pat ! J'en ai besoin : tu as l'expérience , le recul nécessaire pour les écrire, toi ! ». Mais, privé de ma dose d'adrénaline coutumière, je dépérissais. « Diplomatiques » se traduisait pour moi par hypocrites, « économiques » préfigurait un endormissement rapide, quant à « humanitaires », la comédie du French Doctor avec son sac de riz sur l'épaule me secouaient, plus de vingt ans après, d'un franc mépris. J'avais peu lu avant de prendre l'avion. Les commémorations en tout genre - cette année c'était 1914, dans quatre ans on remettrait ça - sans parler de tous les films et livres sur la shoah avaient fini par m'horripiler. Se souvenir, soit, mais de là à s'empêcher de vivre pour macérer dans le jus du passé...Je voulais ne rien savoir par avance ou le moins possible. Découvrir. Après tout, c'était mon métier... Stromae explosait sur les ondes et son « Papaoutai » lancinant laissait résonner en moi les longs regards de silence de Dorothée. Une mode, un album. Tout cela finirait bien par passer.
Le ciel de Kigali était bleu, très haut comme souvent sur la terre d'Afrique. Quelque chose d'impalpable pèse sur votre tête, sans lourdeur, vous obligeant à regarder, isolant un objet, un paysage, un homme, pour distinguer ce qui d'ordinaire reste invisible. Et ce que je voyais me ravissait. Les quelques images ramassées sur internet étaient bien en dessous de la splendeur simple des lieux. Par pur esprit de contradiction, sitôt descendu de l'avion, j'étais parti en jeep à Akagera pour narguer Robert - bien inutilement car il n'en saurait rien - . Je m'étais accordé , à moi seul, mon escapade. A deux heures et demie de route vers l'Est et pour moins d'une centaine de dollars j'ai retrouvé l'admiration et la stupeur de mon premier voyage au Kenya, le plaisir d'une trop brève incursion au Sérengeti tanzanien, derrière le fleuve. Bien sûr, la guerre avait abîmé le parc ; après quoi, il avait fallu le rétrécir pour installer et nourrir survivants et rapatriés. Mais le naturel paisible des bufles, l'élégance des girafes fragiles et les hippopotames broutant, avides, au petit matin frais m'emplissaient à nouveau d'une incroyable paix. J'ai mitraillé, par habitude sans doute, par avidité, des centaines de photos un peu fébriles parfois, où pourtant rien d'autre ne transparaissait que cet accord magique des arbres verts s'élançant avec hardiesse de la terre si rouge vers la beauté du ciel. Placides, les babouins me regardaient. La magie n'existe qu'à l'aune du réel. J'avais un reportage à réaliser. Mais je prenais mon temps. « Imprègne-toi bien de l'ambiance !»m'avait dit Robert. Je m'imprégnais si bien que je décidai de rédiger rien que pour moi quelques pages de l'enchantement qui me tenait. Après toutes les horreurs qui avaient défilé devant mon objectif, je m'étonnais de l'émotion profonde, naïve , chaque jour renouvelée, que me causait encore la vision des animaux. Digne, leur seule violence restait celle de la faim à rassasier.
La jeep avait du kilomètre au compteur, trafiqué bien sûr et la croûte de boue et de poussière qui la recouvrait me rassurait plutôt.De toute façon, mieux valait ne pas trop s'interroger sur son état. Pour Léonard, qui la conduisait, elle n'avait aucun secret. Entre eux c'était une histoire d'amour. Il la bichonnait. Y dormait, souvent y mangeait, ne la quittait guère des yeux. Sa débrouillardise, son T-shirt troué : Chicago en lettres rouges et blanches sur fond bleu, son sourire perpétuel et son abord facile m'ouvraient la confiance des villageois partout où nous passions. Il connaissait tout le monde. Le coffre où il engouffrait parfois, d'où au contraire il sortait souvent des paquets bâchés en échange de quelques billets fiévreux me restait inaccessible. J'emportais toujours avec moi mes appareils. Après quelques jours j'ai fini de m'inquiéter pour ma valise à l'arrière de la voiture : personne n'y toucherait. Je ne me rappelle plus les noms des villages, des victimes, l'exacte description de toutes les horreurs confessées ou racontées à mi-voix. Très vite, j'ai su que je ne pourrais pas retracer sur quelques colonnes, confiner à deux ou trois photos toute la détresse et le sang dont on m'abreuvait. Très vite j'ai compris que ce n'était pas au journaliste que s'adressait l'expérience que je vivais. D'autres étaient venus là avant moi, en même temps que moi, viendraient encore après moi. Ils avaient écrit. Longuement. Ils écriraient encore. Avec éloquence. Alors, qu'est-ce que je faisais ici ? Je pensais à Dorothée. Ma place n'était-elle pas auprès d'elle ? Pris entre lassitude et dégoût, j'attendais je ne sais quoi.
C'est alors que quelqu'un a évoqué brièvement, avec tristesse et un peu d'envie malgré tout, l'histoire de Mavunyi et j'ai su que je devais le chercher. Je suis allé le dire à la Kagera, le soir. Indolente et lisse, elle reflétait le glissement infini des nuages. Les roseaux indifférents ne m'ont pas répondu. J'ai attendu, accroupi, le cœur battant de mon étrange résolution. Soudain, un bec en sabot sortant des papyrus a émis quelques claquements. Avec sa petite houppe derrière le crâne et son lourd appendice nasal, il était aussi gauche que moi.Mais je savais combien son outil est efficace pour trouver, dans une becquée de terre arrachée au marais, la proie qu'il convoite. Gris et sans peur dans le soir rosé, il me regardait droit dans les yeux. Je lui ai souri : moi aussi, je réussirais !
Il m'arrive aujourd'hui encore, de moins en moins souvent parce que je me fais vieux, que le marbre les protège , d'arroser la poussière au -dessus d'elles et ce n'est jamais leur prénom qui, d'abord, revient vers moi comme une conjuration du mal et de la souffrance. Quarante ans après les événements c'est toujours à une autre que je m'adresse, une qui ne m'a pas connu, que je n'ai jamais vue : Emelence . Mais d'abord, c'est lui qu'il nous a fallu trouver. Je ne me rappelle plus son nom ; son prénom seul m'emplit toujours le cœur d'un long serrement. Sans la détermination de Léonard, j'aurais sans doute renoncé tellement cette recherche tâtonnante pouvait paraître vaine. Dans ces temps troublés, les histoires, horribles ou merveilleuses, se répandent vite, leurs héros se modifient : les conteurs ne sont redevables d'aucune exactitude, seulement de la vérité de la substance. Et la substance, à cette heure, sous ce ciel, était terrifiante et poisseuse, vraie à n'en pas douter hélas ! Au hasard de mes déambulations, j'avais accroché cette histoire presque par mégarde et résolu de la démêler. Au Sud-Est, dans la région des chutes, nous avons parcouru plusieurs villages, frappé à des portes, interrogé, recoupé des informations et, au bout de tout cela, j'ai fini par me laisser tomber en sueur, éreinté, sur l'unique chaise de la pièce, en face de Mavunyi. Il ne comprenait pas. D'autres reporters étaient passés depuis vingt ans. Parfois on l'avait nommé Pierre, de son deuxième prénom, mais lui n'aimait pas. «Appelle-moi Mavunyi, ça fera plus « exotique » ajoute-t-il avec un demi-sourire désabusé. » Comme tous ses voisins Mavunyi avait raconté, comme eux, il avait répondu aux questions. Et les journalistes étaient repartis. Sa réserve, son phrasé lent, volontairement détaché me semblait-il, démangeaient ma curiosité.
« C'est toujours la même histoire tu sais.Pour nous tous. Rien n'a changé. Tu la connais puisque tu es ici. » Un sourire infiniment las mais bienveillant me jaugeait. Ironique peut-être ? « Pourquoi es-tu venu, toi ? »
J'ai décollé mes lèvres sèches. J'avais dans la gorge mon discours bien rodé, les accents de sincérité, les formules qui font mouche et toute mon expérience de l'interview. « Je voulais vérifier les choses par moi-même, être sûr du choix de l'angle adopté, affiner un point, éclairer d'autres pans de l'histoire... Je voudrais des photos avec un cadrage particulier, des filtres spéciaux, un objectif différent...Il me semble que... ». Mais rien. J'étais bouche bée. Soudain il ne me restait plus que la vérité. Stupéfait, j'ai fermé la bouche, baissé les yeux ; j'avais dans le cœur, résonnant à l'infinisur les carreaux du corridor, un sanglot de Dorothée. Alors j'ai reniflé, un peu bêtement ; je regardais sans les voir mes deux mains ouvertes sur mes genoux : « Je ne sais pas pourquoi je suis venu...Cette histoire, ton histoire n'est pas pour mon journal... » C'avait été presque imperceptible : Mavunyi s'était redressé, soudain attentif. « ...Je crois...elle est pour moi... » Gêné, j'ai étouffé un mauvais rire et puis soudain j'ai tout lâché : la fatigue, le dégoût, Dorothée à l'hôpital, les commémorations de 14-18, la shoah, le French doctor. Le sol flottait en vagues sous mes yeux au gré d'un refrain têtu. Je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que je pleurnichais un peu au fond de l'obscurité.
Ca n'a pas duré longtemps. Deux, trois minutes ? Soudain, le rythme a resurgi dans ma tête : « Alors on danse ?... » j'ai pensé sottement. Quoi faire d'autre ? J'ai failli rire. Un outil a craqué,ou le bord du lit peut-être et la honte m'a envahi jusqu'aux oreilles. J'ai brusquement refermé mes mains comme on claque une porte. La légèreté du silence m'a surpris. Mavunyi, immobile, attendait de croiser mon regard. Et ça a été comme une accolade, un salut grave. Juste à ce moment, j'ai perçu quelqu'un d'autre à l'intérieur. J'ai tourné la tête vers l'entrée. Un peu courbé, l'homme venait de poser contre le mur, à côté des autres, l'outil qu'il rapportait, une houe je crois. « J'ai terminé les rangées derrière les bananiers. » Me dévisageant à la dérobée, il attendait, indécis. Mavunyi s'est repris, très vite. « Voici Ntibagilirwa, qui m'aide à cultiver depuis... » Il a regardé son pied droit abîmé avec un petit pincement des lèvres. Encore toute une histoire à raconter, sûrement, que je ne saurai jamais.
« Ta fille est chez nous pour la journée, ne t'inquiète pas. » « Merci voisin... » Mavunyi marque un temps. « Je... ne m'inquiète pas. » Il y a dans sa voix une nuance étrange ; je l'ai notée mais suis incapable de l'interpréter. L'homme sort lentement, à reculons, attachant sur moi un long regard de méfiance. J'ai rêvé peut-être. Je n'ai pas aimé les yeux enfoncés, le bourrelet des sourcils sur le front bas. Curieusement, la mâchoire dure, la peau très noire me remuent encore. Et la défiance de l'homme. Je les écarte mais le moment est gâché : je propose à Mavunyi de me retirer. Mes impressions premières sont toujours très entières. C'est ce qui me rappelle qu'un jour, il y a très longtemps, j'ai été jeune.
Une voix étrange répond, à la fois détachée et pénétrée d'une souffrance qui fait mal à entendre. « Désirée aime son fils...Et son fils... aime Désirée je crois. Elle a la beauté de sa mère. »Mavunyi s'interrompt, se perd dans un souvenir, loin. J'ai honte, je suis un charognard ; je répugne soudain à la curée. Je n'ose finir de me relever et oscille, ridicule, les fesses en l'air, en équilibre instable. Sortir au plus vite, fuir la lourdeur de l'instant ! Il me semble que j'étouffe. . « Reste. Je vais te raconter. » Mavunyi s'est repris dans un ricanement amer. « Rien ne m'en empêchera.. » Il me tend un gobelet où je reconnais la traditionnelle et épaisse bière de banane. Cette boisson des campagnes torture depuis quelques jours déjà mes intestins d'Européen. Désolé ! Désignant mon ventre d'un air piteux, je pince les lèvres. Ma grimace est éloquente : Mavunyi a un petit pétillement dans l'oeil.Derrière le lit, il est aller puiser dans la jarre d'eau pour la préparation des repas. Au moment de verser, il se ravise et répand avec gravité quelques gouttes sur le sol. « Pour calmer la poussière ! Quand nous étions à l'école, Emelence s'en chargeait dans la classe, presque tous les matins. » Et dans ma gorge asséchée, c'est bien ce que fait l'eau, curieusement fraîche : calmer la poussière.
****
« Emelence était magnifique... Il n'y a pas de mots pour cela. Lorsque j'étais seul avec elle... au début, j'oubliais presque de respirer. » Une lumière monte de Mavunyi, s'élargit : « C'est comme quand tu descends au fleuve et que l'hippopotame joue avec son petit : jamais tu ne pourras dire combien c'est beau... ça fait peur aussi...» Un homme à peine plus âgé que moi mais dont les cheveux, blanchis par plaques, soulignent l'infortune, songe à sa jeunesse perdue et voici que j'entre de plain-pied dans ce qui, à une virgule du destin près , pourrait être ma propre vie.
Dans ce village comme aux alentours, beaucoup de jeunes hommes désiraient Emelence.Son corps mince aux os fins, légers était une caresse sur le flanc de la colline quand elle partait chercher l'eau. Elle avait la tête petite, des yeux aux cils immenses. Vive, elle détalait en bondissant comme les impalas quand les garçons cherchaient à l'arrêter. Il y avait chez elle la grâce d'une de ses ancêtres afars. Mavunyi était fou de fierté lorsqu'elle l'a choisi. Peut-être savait-il que le prix à payer serait lourd. Mais à quel point... ni l'un ni l'autre ne l'avait imaginé. Ils aimaient seulement l'heure du soir, la fraîcheur des roseaux après la poussière du jour. Comme on entend parler des fantômes, ils savaient les dangers de cette terre, vieille colonie déformée par les blancs mais surtout que leur vie pour toujours était là,entre le vert puissant des collines et le grand fleuve. Travaillant bien à l'école, ils rêvaient entre eux – sans trop y croire – d'aller un jour à la capitale pour étudier. Lui serait juriste, avocat peut-être, elle, infirmière parce que quand on a vingt ans, que l'on mange à sa faim et que les vaches prospèrent, on ne peut que vouloir du bien aux hommes. Amashyo, amashyo ngore !
Mavunyi a travaillé comme un fou dans les champs de ses cousins, chez son oncle ; il a enrichi toute la famille et son père n'a pas hésité à lui donner une vache à lui pour s'installer avec Emelence . En quelques années, le jeune couple a fait des merveilles. Emelence, en plus de son travail aux champs confectionne de la vannerie en papyrus, avec des feuilles de bananier. Elle tresse les roseaux et le bambou, réalise des couvercles de pots à lait. Igiseke, agaseke : son habileté et le soin apporté à la finition des paniers , la technique igihisi dans laquelle elle excellait ont établi sa réputation. Le cousin Rwandekwe vend ses vanneries presque jusqu' à Nairobi ! Il voyage beaucoup et Mavunyi lui a demandé une faveur : puisqu'il se rend de temps à autre au mercato d'Addis Abeba pour ses affaires, qu'il fasse un achat à sa place : une bague artistement travaillée. Les mines d'or de l'Ethiopie sont réputées et les artisans de sa capitale ont du génie dans la délicatesse avec laquelle ils manient le fil d'or, inventent et combinent des motifs, soignent le moindre détail d'une frise. Réclamer un bijou ? Jamais Emelence n'y a seulement songé. Mais avec une émotion contenue, presque honteuse, elle a maintes fois décrit à Mavunyi la splendeur de sa grand-mère drapée dans sa robe rouge, sa haute taille un peu dédaigneuse et la beauté de l'or éclatant sur sa peau noire au soleil du Danakil. Abey, que sa petite-fille n'a jamais connue mais que sa mère lui a racontée, est un modèle de liberté et d'indépendance pour Emelence. Peut-être Mavunyi saura-t-il un jour l'histoire de cette femme fière qui a fui le peuple afar afin de ne pas être mariée de force mais pour l'instant, tout ce qu'il désire c'est s'assurer qu'il mérite encore davantage l'amour d'Emelence. Malgré tous ses efforts, il n'a pas les moyens d'offrir à sa femme cette superbe parure où bracelet et bagues sont unis par une dentelle de chaînettes dessinant un enchevêtrement d'or envoûtant sur les longues mains d'ébène. Mais une bague, oui ! Et du mieux possible il a décrit à Rwandekwe le rêve d'Emelence, ce motif pour elle unique, celui d'Abey qui a su résister sans renier les siens.
Rwandekwe a accompli sa mission : il a négocié, et pour un prix avantageux, un anneau d'or aux reflets chauds. Le travail de l'orfèvre, qui a bien interprété les indications données, son amour de l'art s'y s'expriment avec éloquence. Le cœur du bijou rappelle la forme d'une demi- papaye, effilée à ses extrémités. Au centre, pas de graines noires mais un à-plat martelé. L'anneau s'élargit et s'évide pour rejoindre délicatement chaque pointe et dans l'espace ainsi dégagé s'enroule un fil d'or torsadé. Tout est d'une finesse exquise.
Mavunyi veut attendre la date anniversaire de leur union pour offrir son présent. Au début de juin cela fera deux ans qu'ils sont mariés et Désirée commencera peut-être à marcher. Deux mois de bonheur à imaginer la joie, la reconnaissance dans l'oeil de sa femme, ce sera son cadeau à lui ... Mais quelques jours plus tard, des rumeurs malsaines se propagent ; l'avion du président a été abattu et, comme toujours, les Interahamwe accusent « les cafards ». La radio des mille collines, qui distille son venin depuis presque deux ans, devient plus violente encore. L'opposition entre communautés, jalonnant l'histoire du pays depuis le départ des colonisateurs, est attisée une fois de plus. Emelence lui a maintes fois confié son malaise, sa peur, certains regards pleins de haine ou de sous-entendus qui l'enveloppaient, elle, l'étrangère, la tutsi. Jusqu'alors Mavunyi a dissipé ses peurs : contre les méchants et les imbéciles on ne peut rien que s'efforcer de vivre selon l'évangile, aimer et pardonner. Mais seul sous la nuit, lorsque Emelence et sa fille dorment, il lui arrive souvent de songer à ce destin contraire qui poursuit certains. La grand-mère a fui l'Ethiopie, s'est réfugiée ici et a épousé un tutsi - par quel terrible hasard?- quelques années à peine avant l'exil de 1959. Elle a pu rester au pays avec ses filles et son fils mais a dû courber le dos, vivre en tremblant . Emelence est née un an après le bannissement de son ethnie de l'administration et de l'enseignement du Rwanda. Elle sait qu'en 1990 plus d'un demi-millions de Tutsi, victimes de persécutions, se sont exilés. Elle sait que, depuis quelques années, la suspicion augmente envers les siens, depuis que le F.P.R. réfugié en Ouganda et qui milite pour le retour des réfugiés tutsi dans leur pays, a pénétré au Rwanda. Elle a dit son bonheur à Mavunyi l'année passée quand , à Arusha, on a fini par se mettre d'accord pour rapatrier les réfugiés. Bien sûr, tout toujours est difficile, fragile et menacé, mais leur enfant peut-être ne connaîtra pas la guerre, la défiance incessante. Et à regarder les pique-boeufs sur le dos des hippopotames, dans les marais , elle a voulu croire que les larves mauvaises peuvent être extirpées, que le bec éclatant , jaune ou rouge , d'un oiseau ami peut chasser les mouches et aussi la vermine et les verrues qui dénaturent un grand corps malhabile à se soigner lui-même ; pourvu qu'on ait foi et que l'on travaille dans la bonne direction, la vie vaut d'être vécue. « Aabana mwe !Il faut dormir maintenant...Abana mwe, buriabana mwe ! » Demain le soleil se lèvera une nouvelle fois et si tu es sage mon enfant, nous reviendrons saluer le fleuve. Il est notre vie et bien plus encore.Imana l'a voulu ainsi.
Mais bien vite en ce mois d'avril Mavunyi et Emelence doutent de ce qu'a vraiment voulu Imana. Partagés entre le dieu des chrétiens qu'on leur dit secourable et celui du prophète qui a protégé Emelence depuis l'Ethiopie jusqu'ici, ils sont perdus. De nouveau, les hommes sacrifient aux démons destructeurs ; la folie se relève dans tout le pays, déchirant les familles. Je n'ose plus interrompre Mavunyi pour lui demander des précisions. Sa respiration s'est apesantie. Il s'arrache des phrases par morceaux irréguliers et plus son récit avance, plus il se tasse sur le lit jusqu'à ne plus être qu'une voûte de regrets. « Emelence est partie très tôt un matin en direction de Kabarundo pour prendre des nouvelles d'une de ses sœurs et de ses neveux. Il y avait une demi-journée de marche... Lorsqu'elle est rentrée, ce n'était plus elle. » Mavunyi me regarde intensément ; des larmes lui gonflent les yeux. Tendus, presque exorbités. J'entends sa respiration, difficile. Il réfléchit, longuement, et puisque je suis venu jusqu'ici, si longtemps après, cherche une vérité à me dire. Une clé peut-être pour une des portes qui mènent à l'enfer. Oppressé, j'attends. Je voudrais que mon carnet et mon stylo disparaissent. Je ne peux plus rien noter.
« C'est ce jour-là que je l'ai perdue. Emelence n'a plus jamais souri. Ne regardait que l'intérieur, vide. Son âme a coulé quelque part dans les cailloux, caillé sur les herbes du chemin. Restait le souffle de la peur... » Il répète : « Le souffle de la peur...» et se tait longuement, hébété. « C'est pour ramener Désirée qu'elle est revenue. Sinon... » L'homme abattu mais stoïque revit sa déchirure. En marchant vers sa mort Emelence a rejoint les siens et l'Ethiopie, le pays lointain qui ne sera jamais la terre de Mavunyi. « Près des maisons elle a trouvé un gamin.Les Interahamwe avaient encerclé le village deux jours durant, trié les gens et attendu les ordres. Au matin du troisième, ils ont exécuté à la kalachnikov, frappé à coups de pierres, découpé à la machette. Pillé, violé, incendié tout ce qui n'était pas hutu. Elle a rampé dans les herbes ; elle entendait des gémissements. C'était sa sœur qui agonisait. Elle suppliait qu'on l'achève, dans la poussière rouge, couchée vers le ciel, presque nue à côté du cadavre de Sebishiha, l'un de ses fils. Quelques miliciens étaient encore là. Ca les mettait en joie. Elle a étouffé ses cris, est revenue abriter Désirée. Plus moyen de la raisonner : elle avait sa mort devant les yeux. Me suppliait. Dix fois, vingt fois elle m'a fait jurer de ne pas la laisser souffrir. Elle voulait passer vite, ne pas être violée, battue. ..Ne pouvait plus avaler quoi que ce soit mais donnait le sein à Désirée. Elle la regardait, me regardait. Ses yeux ne me voyaient pas, criaient : « Sauve-la ! » Pour elle-même, elle savait que ce ne serait pas possible. Elle chantait sans cesse à voix basse le chapitre 27 de l'évangile de Mathieu. Nous venions juste de célébrer les Pâques à l'église catholique de Kiabarondo. Une phrase revenait sans cesse dans sa transe : « C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour ». Moi je ne voulais plus le répéter mais elle insistait : « Tu me tueras dis ? promets-le moi ! »
Mavunyi pleurait à présent et tandis que son orteil fouissait avec rage, avec désespoir la poussière sous le sommier, il balançait son buste en me parlant, hypnotisé par les souvenirs. Muet, j'avais du mal à déglutir, presque honte de faire du bruit en respirant. Deux envies égales me tenaient : le faire taire ou bien apprendre tout, dans les moindres détails. Juste à ce moment je crois un souffle a fait tomber un pan de la moustiquaire sur lui. Dans la pénombre de la case un fantôme me découpait l'enfer avec soin, usant du vocabulaire parfois très précis que lui avait inculqué la bienfaisante école des colonisateurs, remâché durant vingt ans.
« Ils avaient déjà bu. Vociféraient dehors. Des insultes, des stupidités. Le groupe a dû les pousser dedans lui et les deux autres. Dieu sait ce qu'il avait pu leur raconter. Tous savaient qu'Emelence l'avait refusé lui, son argent et sa morgue pour me préférer moi et notre enfant. Grâce au ciel, après sa tétée Désirée avait glissé de la planche et dormait profondément par terre, sous le lit,dans un coin. Quand il a vu Emelence en face, il a reculé.Les autres ont parlé. Je ne les connaissais pas. « On ne te veut pas de mal. C'est pour elle qu'on est venus. Donne-la et on s'en va.» Emelence m'a agrippé. Ses doigts enfoncés dans mon bras me paralysaient presque. « On peut négocier ?... »j'ai dit mais je n'y croyais pas. Personne. Ils étaient trop nombreux dehors. On entendait les injures, les ricanements, les appels. Alors, dans la ceinture de celui qui se cachait derrière, je l'ai vue, la délivrance. Les autres avaient des machettes. » Mavunyi s'interrompt, me regarde droit, exigeant : « Lui, un pistolet... Celui de la gendarmerie française.» Je lui rend son regard. Je dis : « Je sais : un Glock 19 ou un Sig-Sauer peut-être ?... » Je me suis renseigné. J'ai fait, il y a quelque temps un reportage sur le G.I.G.N., les forces de police en général, tout ce qui vise, tire, tue et même les armes factices. Je parle , je dis n'importe quoi pour agiter le silence de plus en plus long. Moi qui ai toujours su ménager des respirations, des pauses dans mes entretiens, pour faire monter ou descendre la tension, j'ai perdu les rênes. Je ne supporte pas d'attendre ce qui vient. « ...Non, un Beretta...Je sais que son prénom c'est Pietro. C'était écrit en majuscules sur le canon...ça veut dire Pierre, me confie-t-il dans un souffle.» Il répète : « Pierre Claver...» Il ne me voit plus. Il a les yeux là-bas, dans la pluie des collines, qui roule, infinie, sur les feuilles glacées des bananiers. Je hoche la tête. Ca va s'arrêter....Ca doit s'arrêter sinon je vais...
« Alors j'ai marchandé avec Jean de Dieu. J'ai payé pour qu'il tue ma femme sans la violer, sans la livrer dehors, sans machette. Pour qu'il tire une seule balle, j'ai prié sa miséricorde. J'avais seulement la bague d'anniversaire de notre mariage. Emelence ne l'a jamais vue... C'était mon cadeau : j'ai acheté sa mort.Lui, peut-être qu'il a regretté de les avoir amenés. Il n'a pas osé tirer...Jean de Dieu aussi avait voulu l'épouser...» Du pied, Mavunyi caresse le sol de la case devant lui, égalise la poussière qui ondoie doucement en rides presque imperceptibles. Je romps le silence , avec hargne: « Tu l'as vengée ? » Silence. Un sourire étrange,surhumain, monte sur Mavunyi : « Le cœur déchire... On croit qu'on veut se venger, qu'on ne pardonnera jamais... Mais la vie pleut toujours, la poussière retombe. Et chaque jour passe... un seul à la fois... ne pas regarder trop loin... » J'ai la tête qui tourne un peu. La chaleur. Je pose une autre question ; je ne veux plus écouter le silence :
« Mais alors, qui a tiré ? »
« C'est moi, dit Mavunyi très calme. J'ai tiré dans son cœur. J'avais repéré l'endroit...toutes ces nuits d'insomnie, d'horreur où elle sanglotait ...je la tenais dans mes bras. Je savais...je pensais à ça . Elle avait ses yeux dans mes yeux. Elle a dit merci. Je crois qu'elle m'a souri mais je ne suis pas sûr. J'ai tiré encore une fois. Elle est morte tout de suite, les yeux ouverts. Désirée a ce sourire-là... »
J'ai fondu en larmes. « C'est la fatigue, j'ai dit. » Mavunyi s'est levé, est venu me consoler. « C'est fini.Ca fait si longtemps... Tu ne raconteras pas tout dans les journaux ; c'est pour toi. » Sa main est sur mon épaule. « Aimer c'est difficile...Que tu aies le courage ! » Quelque chose en moi se révolte. Et ce Jean de Dieu qui mérite si mal son nom, il est vivant encore ? Il a payé ? « Tu l'as accusé devant les gacacas au moins ? »
« J' ai pensé le faire mais il a tout de suite regretté. Il m'a demandé pardon. Je crois qu'il n'a tué personne. Dès qu'il est entré ce soir-là et qu'il l'a vue, il regrettait déjà... Il avait un fils, petit. »
« Il vit toujours dans le village ? C'est quoi son nom Rwandais ? »
« Bien sûr. Tu l'as vu. C'est Ntibagilirwa . » Et Mavunyi désigne la houe que le voisin a posée contre le mur tout à l'heure.
****
Un froissement dans le drapé lourd de l'air qui fraîchit à l'extérieur. Des pas précipités sur la terre durcie : « Papa ! Papa, il m'aime. Vraiment. Il veut m'épouser. »
« Désirée, voyons ! Nous avons un hôte ! »
« Regarde ce qu'il m'a offert !» Je vois la face de Mavunyi se décomposer devant une bague d'or très délicate. C'est un à-plat ovale effilé à ses extrémités. Avant de se rejoindre pour former l'anneau aux reflets chaleureux, deux fins rubans du même métal enserrent une torsade de fils d'or. Tout est d'une finesse exquise. Et dans les larges yeux noirs de Mukanoheli qui sourit à son père, l'amour est absolu. Face à moi Mavunyi vacille sur le lit . Il vient d'en saisir le bord ; sa jambe droite va chercher sous le sommier je ne sais quelle force pour le soutenir. Je n'ai pas posé tantôt la question de la tombe et une impression folle me saisit tout à coup. J'ai presque la certitude qu'Emelence est là, sous le lit, protégée, dans la calme pénombre où gît la poussière de la terre rwandaise. Mavunyi l'a gardée avec lui, avec Désirée et lorsqu'il sera mort, la sève de cette terre dont les racines puisent en Ethiopie nourrira jalousement Désirée, son mari s'il l'aime et les enfants de leurs enfants.
Après-demain soir, à Kanombé, je reprends l'avion pour Paris. Là-bas j'ai du travail : des photos d'animaux à trier, un article à rendre. Robert compte sur moi. Mais avant, je vais écrire quelques pages. Pas des pages à publier, juste pour ma fille quand elle sera grande - Dorothée m'a prévenu par S.M.S. : ce sera une fille- quelques pages qui lui expliqueront l'Afrique, les hippopotames le soir , la poussière partout sur la terre, près des fleuves et son deuxième prénom : Mukanoheli.
Amashyo, amashyo ngore!:salut adressé à quelqu'un : on lui souhaite d'avoir des troupeaux
Igiseke, agaseke, igihisi:types de paniers tressés et styles utilisés
Abana mwe!Buriabana mwe !: les enfants, il fait nuit !
Gacacas:tribunaux populaires établis pour juger les crimes de génocide au Rwanda, trop nombreux pour la justice ordinaire
Interahamwe : milices établies par le pouvoir hutu pour s'opposer aux tutsi de l'intérieur (« cafards ») ainsi qu'aux réfugiés qui auraient voulu rentrer au pays . Grâce à l'armement fourni par des puissances occidentales et à leur formation militaire elles ont planifié et exécuté le génocide. (Elles se sont appuyées sur la population locale hutu endoctrinée par la radio des mille collines.)
obi- Nombre de messages : 553
Date d'inscription : 24/02/2013
 Re: Calmer la poussière
Re: Calmer la poussière
calmer la poussière ( sous le tapis, avec les soucis place au mot envie)
So-Back- Nombre de messages : 3652
Age : 100
Date d'inscription : 04/04/2014
 Re: Calmer la poussière
Re: Calmer la poussière
J'avais voulu répondre au tout début!
Mais bon...
Que dire? A la lecture , on sent que cette histoire te tient à coeur, et que de toute façon tu n'aurais pas pu t'abstenir de l'écrire!
Elle est très chargée émotionellement, j'ai eu l'impression que tu voulais en mettre le plus possible.
D'autre part le début est très confus, pour un format court. Il m'avait fallu plusieurs lectures, je m'en souviens, et même aujourd'hui; je ne suis retombée sur mes pattes qu'à la fin.
Ceci pour te dire que c'est le format "nouvelle" qui n'est pas adéquat, c'est trop touffu et la chute n'est ni spectaculaire ni étonnante ni ne justifie le déroulé précédant.
Cependant c'est un très bon texte, qui se lit avec plaisir, et intérêt, et tu as bien fait de le mener jusqu'au bout!
Et j'espère que tu en as d'autres sous le coude!!!
(dernier mot: merci de nous faire partager tes questionnements, ces échanges donnent tout leur sens à ce forum)
Mais bon...
Que dire? A la lecture , on sent que cette histoire te tient à coeur, et que de toute façon tu n'aurais pas pu t'abstenir de l'écrire!
Elle est très chargée émotionellement, j'ai eu l'impression que tu voulais en mettre le plus possible.
D'autre part le début est très confus, pour un format court. Il m'avait fallu plusieurs lectures, je m'en souviens, et même aujourd'hui; je ne suis retombée sur mes pattes qu'à la fin.
Ceci pour te dire que c'est le format "nouvelle" qui n'est pas adéquat, c'est trop touffu et la chute n'est ni spectaculaire ni étonnante ni ne justifie le déroulé précédant.
Cependant c'est un très bon texte, qui se lit avec plaisir, et intérêt, et tu as bien fait de le mener jusqu'au bout!
Et j'espère que tu en as d'autres sous le coude!!!
(dernier mot: merci de nous faire partager tes questionnements, ces échanges donnent tout leur sens à ce forum)

Polixène- Nombre de messages : 3287
Age : 61
Localisation : Dans un pli du temps . (sohaz@mailo.com)
Date d'inscription : 23/02/2010
 Re: Calmer la poussière
Re: Calmer la poussière
Le procédé de la narration interne met bien en perspective l'histoire parallèle du personnage européen et celle de son interlocuteur africain, définissant ainsi des enjeux de civilisation bien différents. Le fait de raconter, dès le début, des éléments de la fin du récit crée un effet d'attente bienvenu. De même, le retour du bijou, tout particulièrement dans sa description précise, donne un relief tout à fait bouleversant à la fin du texte. Le point d'appui de la narration, l'aveu du narrateur ("Stupéfait, j'ai fermé la bouche, baissé les yeux... je crois que je pleurnichais un peu au fond de l'obscurité."), est bien mis en scène : positionnement choisi et attitude, effets stylistiques (hyperbole : "à l'infini sur les carreaux du corridor", procédé d'accumulation : "la fatigue, le dégoût, Dorothée à l'hôpital, les commémorations de 14-18, la shoah, le French doctor."). L'expression de ce désarroi rend somme toute plausible la perspective de la confidence intime et du compte-rendu macabre, par son interlocuteur, des horreurs traversées. Les éléments à caractère ethnique et historique (langage propre aux personnages, objets du quotidien, mention des "Gacacas", des "Interahamwe"), s'incorporent sans troubler le fil de la narration. Le lecteur est particulièrement sensible à l'antinomie radicale, posée par l'auteure par l'entremise de son personnage, entre beauté magnifiée de l'Afrique (de sa faune, de sa flore) et horreur des abominations qui se perpètrent au Rwanda et dont les hommes seuls portent l'épouvantable responsabilité. Le choix du titre ("Calmer la poussière") semble obéir à une volonté de mettre en relief, plus que le sens premier de l'expression, son sens métaphorique. La poussière est semblable à cette haine sauvage, viscérale, jamais véritablement apaisée, qui remonte invariablement, semant son monstrueux carnage.
Merci pour ce partage !
Merci pour ce partage !
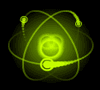
jfmoods- Nombre de messages : 692
Age : 58
Localisation : jfmoods@yahoo.fr
Date d'inscription : 16/07/2013
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|

 Accueil
Accueil Conversations
Conversations Prose
Prose Poésie
Poésie Exercices
Exercices Catalogue
Catalogue Rechercher
Rechercher S'enregistrer
S'enregistrer Connexion
Connexion
